PORTRAIT DE DUPEYROU
PAR
RECTEUR PROFESSEUR A LA FACULTÉ DES LETTRES A L'OCCASION DE SON INSTALLATION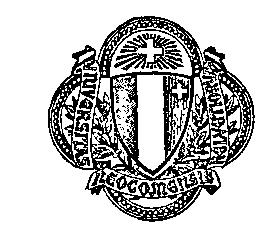
NEUCHATEL SECRÉTARIAT DE L'UNIVERSITÉ 1955PIERRE-ALEXANDRE DUPEYROU
Sur la belle demeure que DuPeyrou se fit construire «au Faubourg», entre 1765 et 1770, nous sommes aujourd'hui très exactement renseignés. Mais une sorte de mystère environne encore la personnalité de DuPeyrou lui-même. Sa vie nous demeure mal connue. Et plus mal sa pensée, comme aussi les sentiments qui firent battre «ce coeur», que J.-J. Rousseau disait «sombre et caché» 1.
Depuis longtemps la figure de DuPeyrou m'intéresse. Sans prétendre lui faire avouer son secret, j'aimerais à la dégager de la pénombre où elle se dissimule. Entreprise délicate, car DuPeyrou lui-même a multiplié les précautions pour ne pas être deviné. Le 31 octobre 1794, soit à peine quinze jours avant sa mort, il écrivait à Mme de Charrière:
Je n'ai pas encore le talent ni le pouvoir de régner en despote sur mes pensées, encore moins sur mes sentiments. Tout ce que j'ai pu imaginer de mieux, c'est de me rejeter sur le passé... Je m'explique. Dès que j'ai terminé ma besogne de la journée..., je défais un paquet du temps passé, resté cacheté, étiqueté, depuis trente à quarante ans, et dont il ne me reste aucun souvenir. Je les y retrouve tous... Quand j'ai lu le paquet, je le mets au feu... Mais il in's fâché beaucoup de brûler des choses charmantes en vérité... II y a trois jours que j'ai brûlé le plus charmant roman du coeur féminin... 2.
Ainsi, dans le silence de sa bibliothèque ou de son cabinet de travail, DuPeyrou, séparé du monde par sa surdité, se livre «à la recherche du temps perdu». Il refait le chemin d'une vie riche d'expériences; il s'attarde un moment à telle étape heureuse... Puis il efface la trace de ses pas. Ce passé, il sera seul à le connaître. Et, dans son testament, l'ordre
La planche illustrant cette étude est un dessus de porte peint se trouvant aujourd'hui 20, rue du Coq-d'Inde à Neuchâtel. U doit provenir, comme certains éléments de la façade, de l'ancienne maison DuPeyrou à la rue de l'Hôpital, détruite pour dégager l'hôtel de ville en construction (1785). On sait que l'entrepreneur Jonas-Louis Reymond reconstruisit sa maison du Coq-d'Inde à l'époque où II achetait les matériaux provenant des immeubles démolis pour faire place à l'actuelle rue du Concert.
est formel: «Je veux que tous les paquets que l'on trouvera parmi mes papiers, cachetés et portant un ordre de brûler, soient mis au feu, sans avoir été ouverts, vu qu'ils ne renferment rien qui intéresse mes héritiers 1. » L'exigence de DuPeyrou fut respectée. De ses archives personnelles — mis à part «les papiers manuscrits de Rousseau» —rien, ou presque rien, à ma connaissance du moins, ne nous est parvenu. DuPeyrou n'a pas voulu que les siens, après sa mort, fussent informés de certaines circonstances de sa vie intime, ni sans doute des relations qu'il avait entretenues avec tel ou tel de ses contemporains. «La tombe aime tout de suite le silence», disait Mallarmé. Ce silence, DuPeyrou paraît l'avoir désiré. Et si, aujourd'hui, je cherche à le rompre, ce n'est point que m'animent la curiosité de l'anecdote ou la divulgation de quelque scandale, mais le sentiment qu'à être mieux connue, et, autant qu'il est possible, mieux éclairée, la figure de DuPeyrou se revêt d'une humaine signification et d'un attrait intellectuel, à quoi l'on ne saurait demeurer insensible.
Les couleurs du portrait que je vais maintenant esquisser, peutêtre se demandera-t-on où je vais les prendre, DuPeyrou nous les ayant soigneusement refusées. Libre de détruire ou de faire détruire des dossiers qui étaient en sa possession, il n'a pu cependant exiger que des lettres écrites par lui soient, du même coup, supprimées. Il y a, d'abord, sa correspondance avec Rousseau: il en avait exigé la conservation. Il y a ensuite un dossier de lettres à Marc-Michel Rey, l'éditeur principal de Jean-Jacques. Il y a enfin le dossier des lettres à Mme de Charrière. C'est, on le voit, par sa correspondance que, peut-être, nous réussirons à connaître un peu mieux DuPeyrou. Lié très étroitement à l'un des plus grands écrivains du siècle, il n'est pas écrivain lui-même. Seul, le désir de défendre Rousseau put le décider, en 1765, à donner au public la Lettre, dite de Goa. Plus tard (1789-1790), le même souci d'assurer la réputation posthume de son illustre ami l'engagea dans une polémique, bientôt suivie de la rédaction d'un Discours préliminaire à l'édition neuchâteloise de la seconde partie des Confessions. Certes, ces textes imprimés permettent de préciser quelques traits de la figure de DuPeyrou; ce ne sont pas, cependant, ceux auxquels je recourrai de préférence.
Une autre source de renseignements, fort précieuse, quoique plus délicate à utiliser, m'a été signalée par M. Jean Courvoisier, dans sa belle étude du Musée neuchâtelois (1952) sur L'Hôtel DuPeyrou et ses propriétaires successifs: c'est l'inventaire qui fut fait, un mois après la mort
de DuPeyrou, de son mobilier, et, en particulier, des livres de sa bibliothèque. Cet inventaire, ouvrage par ouvrage, les titres seuls, souvent, étant relevés, et encore avec des erreurs, je l'ai mis sur fiches, et ces fiches, je les ai classées. Or, pour peu qu'on ait une connaissance suffisante de la littérature du XVIIIe siècle, tout cela — qu'on pourrait croire fastidieux — se révèle d'un très vif intérêt. Les goûts d'un amateur distingué s'y montrent, ses préoccupations, les tendances de son esprit et le caractère encyclopédique de sa culture.
Il est un groupe, encore, de documents dont je vais, naturellement, faire état: ceux où DuPeyrou nous apparaît tel que l'ont vu ses contemporains: Rousseau et Mmc de Charrière, le pasteur de Montmollin et d'Escherny, ou encore le baron de Chambrier d'Oleyres, dont le Journal contient, sur DuPeyrou, des renseignements encore inédits.
Dernier préliminaire à mon étude: nous ne possédons aucune lettre personnelle de DuPeyrou antérieure à septembre 1764. Il est, alors, dans sa trente-sixième année. Son enfance, sa jeunesse, l'époque si importante des études: tout cela nous échappe autant dire complètement. Rappeler que Pierre-Alexandre DuPeyrou est né, le 7 mai 1729, à Paramaribo (Guyane hollandaise); qu'il était le fils d'un conseiller à la Cour de justice de Surinam, Pierre DuPeyrou, dont la famille, originaire de Bergerac, s'était, après la révocation de l'Edit de Nantes, réfugiée dans les Provinces Unies; qu'en 1739, âgé donc de dix ans, Pierre-Alexandre fut amené en Hollande, où il fit ses études; qu'en 1743, sa mère, née Lucie Droilhet, devenue veuve, épousa en secondes noces Philippe Le [ou de] Chambrier, colonel au service des Etats-Généraux de Hollande et commandant en chef de la province de Surinam; qu'en 1747 Chambrier vint, avec sa femme et son beau-fils, finir ses jours à Neuchâtel, où il mourut en 1754; enfin, que DuPeyrou, le 9 décembre 1748, soit à dix-neuf ans et demi, fut reçu bourgeois de Neuchâtel: rappeler ces quelques faits et dates, c'est dire tout ce que l'on sait précisément de la jeunesse de DuPeyrou.
Nous en savons moins encore sur la période qui s'étend de 1748 à 1764. Je ne connais qu'un seul texte qui jette sur ces années de la vie de DuPeyrou un peu —très peu —de lumière: c'est le Journal de Chambrier d'Oleyres 1. Encore faut-il préciser que Chambrier, né en 1753, ne
fait que rapporter ce qu'il a entendu raconter dans sa famille. Voici ce qu'il note, en le situant au mois de «juin 1747»:
Philippe Chambrier, revenu de Surinam, arriva à Neuchâtel avec sa femme et son beau-fils, Alexandre DuPeyrou. Celui-ci fut tellement frappé de Julie Chambrier, fille du trésorier, qui était alors dans toute la fleur de sa grande beauté, qu'il fit pressentir le trésorier pour un mariage; mais la jeune personne était déjà engagée à Abraham Pury, circonstance dont les influences ont été incalculables. DuPeyrou resta l'ami de la femme du mari [l'expression est amusante!] qui prit le plus grand ascendant sur son esprit; de sorte que le jeune homme simple, doux, modeste..., chéri de tous les siens et s'annonçant sous les plus favorables auspices, devint, au bout de quelques années, par les flatteries de son ami et de nombre de jeunes gens qui l'adulaient, presque un étranger aux moeurs et aux usages de Neuchâtel. Très disposé à s'y croire supérieur par l'éclat de sa fortune et des lumières philosophiques, on verra à quel point il fut malheureusement entraîné, par la fougue de ses passions et le désir d'être chef de secte à Neuchâtel, dans une conduite dont les suites devinrent fâcheuses pour lui et, à certains égards, pour le pays 1.
Ainsi donc, dans les premiers temps de son installation à Neuchâtel, DuPeyrou aurait éprouvé une déception amoureuse, dont Chambrier prétend que les suites «ont été incalculables». Comment interpréter cette assertion? Mme de Pury demeura pour DuPeyrou une amie; son mari, d'autre part, de cinq ans plus âgé que DuPeyrou, se lia étroitement avec celui-ci, exerçant sur son esprit «le plus grand ascendant». — Nul n'ignore qu'Abraham Pury est l'homme de la Chronique des Chanoines et des Mémoires du Chancelier de Montmollin, une des figures les plus curieuses, énigmatique aussi, de la politique neuchâteloise, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. — L'attachement de DuPeyrou à ses amis Pury fut tel qu'il en vint, en 1769, à l'âge de quarante ans, à épouser leur fille, Henriette-Dorothée, née le 27 décembre 1750. Annonçant à Rey son mariage, DuPeyrou écrit: «L'objet de mon choix est une personne que j'ai vue presque tous les jours depuis celui de sa naissance, que j'aimais comme on aime son enfant, et qui a préféré de me faire porter le titre de son mari à celui de père que j'eusse adopté pour elle 2. » Il est permis de penser que la vie sentimentale de DuPeyrou fut, en une certaine mesure en tout cas, orientée par l'amour malheureux de sa jeunesse. Dans cette belle enfant de dix-huit ans et demi, n'est-ce pas un peu l'image de Julie de Chambrier qu'il poursuit et qu'il espère rejoindre?
Celle qui, autrefois, lui avait, été refusée, ne va-t-il pas pouvoir, enfin, la chérir, l'envelopper d'une affection quasi paternelle, en la personne de cette fille, depuis longtemps aimée «comme on aime son enfant»?
Mais, vers 1750, le DuPeyrou de vingt ans, jusqu'alors «simple, doux, modeste», traverse une crise à laquelle, sans doute, son amour déçu n'est pas étranger. Majeur, en possession d'une grande fortune, il jouit de sa liberté. Son beau-père meurt. Sa mère, qui l'adore et à qui il rend sa tendresse, lui laisse les coudées franches. La «fougue de ses passions» l'entraîne. Souvent, ses affaires le conduisent à l'étranger, en Hollande, à Paris. A voir le catalogue de sa bibliothèque, je présume qu'il dut faire aussi le voyage d'Italie. La petite ville où des circonstances de famille l'ont fixé lui est étroite; notre climat moral lui pèse. Il cherche ailleurs des distractions, des plaisirs, au point de devenir presque «étranger aux moeurs et aux usages de Neuchâtel». Aucun document antérieur à l'époque de la correspondance avec Rousseau ne nous renseigne sur DuPeyrou homme de plaisir. Mais je ne crois pas abuser des textes en pensant que certains aveux faits à Jean-Jacques à ce sujet sont valables tout aussi bien — ou plus encore! — pour la période qui précéda celle de leurs relations. En 1766, alors que DuPeyrou souffre déjà de ces accès de goutte, qui devaient aller toujours s'aggravant, il fait, dans une lettre qui, hélas! ne nous est pas conservée, des confidences à Rousseau sur sa vie intime. Et le Citoyen de lui répondre: «Je ne suis point content de ce que vous m'avez écrit à ce sujet. Ce que vous regardez comme la consolation de votre existence est précisément ce qui vous la rend à charge... Je vous prêche un jeûne que l'habitude contraire a rendu fort difficile, je le sais bien... Cependant, il faut moins chercher à vaincre qu'à éviter le combat.» Et Rousseau de suggérer à son ami des distractions, des études comme celle de la botanique: «Quand, écrit-il, on a bien herborisé dans les rochers pendant la journée, on n'est pas fâché, le soir, d'aller coucher seul... Tel curieux analyse avec plus de plaisir une jolie fleur qu'une jolie fille 1. » DuPeyrou promet alors «de ne pas rechercher les occasions prochaines». Il ajoute: «Je voudrais bien vous promettre encore plus, mais je veux toujours pouvoir tenir ma parole. Au fond, le pays que j'habite [la lettre est datée de Neuchâtel!] est un grand correctif à la pente de la nature... Je sens bien que je serais un homme perdu, si je vivais dans un Paris, car je suis faible 2. »
Que DuPeyrou, entre vingt et quarante ans, ait été fort «épicurien»
—le mot lui est appliqué par d'Escherny —; qu'il ait jugé, avec Buffon, qu'en amour il n'y avait que le physique qui fût bon, les textes que je viens de citer l'attestent suffisamment. Dans la correspondance avec Rousseau, je relève quelques allusions à des aventures amoureuses, qui nous demeurent obscures. Ainsi, en 1765, Jean-Jacques renvoie à DuPeyrou une lettre de femme, que celui-ci lui a communiquée. De cette femme, écrit Rousseau, «vous devriez en faire non votre amie, mais votre folle... 1 ». En janvier 1766, DuPeyrou parle d'un ami qu'il a en Angleterre, M. de Cerjat:
Sur les nouvelles qu'on lui a données de mes démêlés avec le sicaire de Môtiers [c'est le pasteur de Montmollin] et les suites dont on me menaçait, la lapidation et mon Histoire amoureuse [?], voici ce qu'il m'écrit: «Voilà donc le ministre, les pierres, les femmes qui vont t'assaillir de tout côté. Crois-moi, jette les pierres aux femmes, les femmes au ministre, et le ministre à son maître Belzebut... 2.
La même année, en juin, Rousseau, évoquant le projet de ce monument funéraire que DuPeyrou avait rêvé d'élever dans ses jardins, écrit à son ami: «Les idées tristes mais douces qu'il me rappelle valent sûrement mieux que celle du bal de votre folle amie 3 .» «Histoire amoureuse», «folle amie»: autant d'allusions indéchiffrables. A moins que, retenant cette date de «juin 1766», il ne faille rapprocher ce dernier texte du passage suivant du Journal de Chambrier d'Oleyres:
M. DuPeyrou parut étranger à ces affaires [il s'agit de la politique neuchâteloise en 1766 et de l'affaire dite «des fermes»] absorbé par une passion violente pour Mme Vattel, qui venait d'arriver à Neuchâtel avec son mari malade; elle avait la figure la plus séduisante, tout l'art de la coquetterie la plus raffinée, rougissant, pâlissant même à son gré 4.
C'est en effet, pendant l'été de 1766, un an avant sa mort, qu'Emer de Vattel, l'auteur du Droit des Gens, fit avec sa jeune femme — «une très jolie Polonaise», écrit un correspondant de Voltaire — un séjour à Neuchâtel.
Ce DuPeyrou qui, pendant des années, avouait lui-même flamber «d'un feu trop vif» 5, n'était nullement, d'ailleurs, une tête brûlée. Il avait été «élevé avec assez de soin», dit Jean-Jacques, dans les Confessions.
«Son éducation lui avait profité... Il se piquait surtout d'avoir cultivé sa raison 1. » Je croirais volontiers qu'entre 1750 et 1760 le milieu neuchâtelois lui parut d'une assez affligeante médiocrité intellectuelle. Le niveau des études était alors, en notre ville, fort bas. Les idées nouvelles trouvaient peu d'accueil. A lire notre Mercure suisse, oh s'aperçoit que les Discours de Rousseau inquiétèrent et que la naissante Encyclopédie, très vite, souleva les objections des gens bien-pensants. La Vénérable Classe exerçait sur les moeurs comme sur les idées un contrôle sévère. En 1754, à peine installé en notre pays au titre de gouverneur, Milord Maréchal en sut quelque chose. Il lui fallut, dans une cérémonie officielle, subir le sermon d'un pasteur qui, dit-il, lui parut avoir «le museau triste de Calvin 2 ». Les tracasseries sacerdotales se multipliaient. A Berlin, Frédéric II déplorait l'étroitesse et le fanatisme de la plupart de nos ministres, «une mauvaise engeance», écrivait-il, «qui ne vise qu'à établir la tyrannie des consciences, qui fronde tous les agréments de la société.., et ne donne qu'une chimérique espérance dans la place des réalités dont on pourrait... jouir tranquillement 3 ». Quelques Neuchâtelois partageaient l'opinion du souverain. DuPeyrou était du nombre. On peut penser qu'en Hollande déjà il avait été touché de quelques reflets des «lumières» philosophiques. Les voyages avaient contribué à former son esprit, à éveiller ses curiosités. Chambrier d'Oleyres, sous la date de février 1760, écrit:
M. DuPeyrou, qui avait fait à cette époque un voyage à Paris et qui fut initié chez le baron d'Holbach aux mystères de la secte philosophique antichrétienne, en rapporta un zèle ardent pour les progrès du philosophisme... Il se forma chez lui une réunion d'amis et de complaisants, où la doctrine de la secte, le plus pur matérialisme, fut pleinement adoptée 4.
Chambrier d'Oleyres —je le rappelle —parle d'ouï-dire, mais rien ne nous permet d'infirmer le renseignement qu'il nous donne ici. Que DuPeyrou ait rencontré, à Paris, Je baron d'Holbach et fréquenté ce salon que Diderot appelait «la Synagogue de la rue Royale», c'est fort possible. Il est certain, d'autre part, qu'il rendit visite à Voltaire, à Ferney. Chambrier, cependant, exagère, lorsqu'il fait de DuPeyrou, à Neuchâtel, le «chef» de la «secte» philosophique. Qu'il ait eu plaisir à
s'entretenir avec des amis choisis et sûrs des nouveautés littéraires, des événements intellectuels qui, s'ils laissaient indifférents la plupart des Neuchâtelois, passionnaient ailleurs l'opinion, cela encore me paraît conforme à tout ce que nous pouvons savoir de celui que d'Escherny jugeait «philosophe» et «le plus honnête homme qu'il eût jamais connu». Mais de là à faire de lui un sectaire du matérialisme «le plus pur», il y a loin. Il y a, précisément, toute la distance qui sépare Voltaire déiste de l'auteur du Système de la Nature. Ce que Chambrier d'Oleyres, en réalité, ne pardonne pas à DuPeyrou, ce n'est pas tant ses opinions philosophiques que son attitude dans l'affaire du pasteur Ferdinand-Olivier Petitpierre et dans les pénibles démêlés de Rousseau avec notre Vénérable Classe. DuPeyrou, pour beaucoup de nos ancêtres, comme pour quelques-uns de nos contemporains, eut le tort impardonnable de ne pas «penser bien», d'oser être libre. Sa fortune lui permettait, plus qu'à d'autres, une absolue indépendance. Et puis, tout bourgeois qu'il fût de Neuchâtel, il n'était pas d'ici, pas plus que Milord Maréchal, que lord Wemyss, que Mme de Charrière. Certes, dans la Lettre de Goa, il parle de sa «patrie d'adoption». Dans une lettre à Rousseau, pendant l'affaire des fermes, il s'inquiète pour [sa] «pauvre petite patrie d'affection 1 ». Mais, plus souvent, il se sent à l'étroit dans notre ville. Il rêve de quitter Neuchâtel, «le pays le plus abominable qu'il puisse y avoir sous la voûte du ciel 2 ». Rousseau parti, il se sent «déjà dégoûté» (c'est son mot) de la bâtisse qu'il est en train de faire construire. Il voudrait s'en débarrasser: «Allons, écrit-il au Citoyen, allons nous établir en Angleterre, à Gibraltar, ou en Amérique! 3 » Plus tard encore, il se désigne à Mme de Charrière par ces mots: «Moi, étranger 4. » Ses amis neuchâtelois sont conscients de ce caractère d'indépendance et y voient une supériorité. Abraham Pury, dans les Remarques publiées à la suite de la Lettre à Lord Wemyss, écrit: «M. DuPeyrou..., un étranger..., homme du monde... et qui jouit de l'avantage inappréciable d'être libre à tous points de vue 5. » Cette liberté d'action, comme de pensée, permit à DuPeyrou de voir et de juger de haut des événements où beaucoup de nos ancêtres trouvèrent l'occasion d'assouvir d'assez misérables rancunes personnelles et de mener, avec un goût excessif de la chicane, de médiocres intrigues.
En 1760, dans l'affaire Petitpierre, DuPeyrou demeura spectateur, sympathisant aux tracas de Milord Maréchal, approuvant, je pense, l'attitude des conseillers d'Etat Chaillet et Ostervald, déplorant certainement l'intolérance de notre clergé à l'endroit de Petitpierre, théologien distingué, dont le seul défaut était de ne pouvoir prêcher l'éternité des peines de l'Enfer. Mais, en 1765, lorsqu'à la suite de la publication des Lettres de la montagne la situation de Rousseau à Môtiers commença de devenir fâcheuse, DuPeyrou se fit le champion du philosophe, contre qui se multipliaient les attaques. Chambrier d'Oleyres, une fois de plus, va nous expliquer à sa manière ce que fut alors le rôle de DuPeyrou:
[«Adepte» de la «secte» philosophique, «aucun n'était plus propre» à en «propager les principes»]: Il portait dans les affaires un zèle, une suite et une activité qui lui rendaient comme propres et personnelles toutes celles dont il se mêlait pour autrui. Personne n'a poussé plus loin la droiture, la probité et les sentiments généreux. [Notons, au passage, cet éloge.] Personne n'était plus propre à donner d'excellents conseils; personne n'en prit de plus mauvais pour lui-même, parce qu'il était toujours livré à ses passions.
Chambrier en vient ici, je crois, à déformer l'image d'un homme pour qui il n'éprouva jamais de sympathie. Il continue: [M. DuPeyrou] «fut, à Ferney, prendre les instructions du Patriarche de la secte, avec qui il entretint des relations suivies, et il fut considéré par Voltaire comme tellement propre à propager les doctrines des Encyclopédistes et si méritant par son zèle, qu'il lui pardonna ses liaisons intimes avec Rousseau, quand ce dernier eut rompu avec lui 1. » Voilà donc DuPeyrou transformé, aux yeux de Chambrier, en agent, à Neuchâtel, mais en agent principal, de la «secte», en séide de Voltaire, exécutant des instructions venues de Ferney. L'explication est, décidément, trop simple. Je vois mal, quant à moi, DuPeyrou défendre Rousseau comme il l'a faIt, écrire la Lettre de Goa, et être en même temps au service de Voltaire. Bien sûr, avec Voltaire et les Encyclopédistes, comme avec Jean-Jacques, comme avec Milord Maréchal et Frédéric II, il est du parti de tous ceux qui luttent pour la tolérance religieuse. Mais il n'ignore pas que le Patriarche de Ferney intrigue, par personne interposée, contre le solitaire de Môtiers-Travers. Or, s'il eût été, en 1765, cet agent de la «secte» que prétend Chambrier, aurait-il, dans la Lettre de Goa, dénoncé, à la suite d'un «Anonyme» renseignant la Vénérable Classe, les manoeuvres de ce «quidam à robe noire, qui voudrait faire montre de son crédit aux D***,
aux de V***, émules ou ennemis de notre fameux Rousseau? 1 » Derrière ces initiales, il n'est pas difficile de retrouver D'Alembert (ou Diderot) et Voltaire. Ce quidam, DuPeyrou le désigne, dans une note, par des initiales transparentes elles aussi: M. E. B. P. à B. = «Monsieur Elie Bertrand, pasteur à Berne». Bertrand, «jésuite jusqu'au bout des ongles», selon l'expression de DuPeyrou dans une lettre à Rousseau 2, était lui, véritablement, un agent secret de Voltaire, comme l'a fait voir, de façon irréfutable, mon cher collègue Louis-Edouard Roulet, dans sa thèse sur Voltaire et les Bernois. Dénoncer ainsi le cauteleux Bertrand, ce n'est pas, me semble-t-il, se mettre aux ordres de Voltaire. Et que penser d'un autre passage de la Lettre de Goa? Après avoir reproduit une lettre de Rousseau au procureur général de Meuron 3 — lettre dans laquelle le Citoyen, faisant allusion aux menées de nos pasteurs, écrit: «Ils sont fort les maîtres de m'excommunier, si cela les amuse; être excommunié de la façon de M. de Voltaire m'amusera fort aussi» [entendons bien la tournure: de la façon: non pas à la manière de M. de Voltaire, mais grâce à l'action de M. de Voltaire!] —DuPeyrou introduit une note : «On s'étonnera de voir ce nom célèbre [celui de Voltaire] à côté de celui de notre Vénérable Classe. La chose s'explique par une lettre que M. de V*** doit avoir écrite à Paris, et dans laquelle on assure qu'il se faisait fort de parvenir à chasser le pauvre Rousseau de sa nouvelle patrie, en dépit de la protection du souverain 4. » DuPeyrou dénonce, on le voit, non seulement les manoeuvres de Bertrand, mais celles de Voltaire. Est-ce donc là agir en séide du Patriarche? On me permettra de n'en rien croire. DuPeyrou voit, je le répète, la situation de haut. Ce Rousseau qu'on accable de toutes parts, il le défend aussi bien contre les entreprises de Voltaire et de Bertrand que contre celles de nos pasteurs, qu'il appelait, lui, nos «lamas». Ceux-ci font preuve d'une affligeante étroitesse d'esprit; ceux-là, feignant l'indignation à la lecture des Lettres de la montagne, cherchent à assouvir de vieilles rancunes (c'est le cas pour Voltaire) ou de misérables ambitions (c'est le cas pour Bertrand). Un jour de février 1765, DuPeyrou a rencontré Bertrand, à Yverdon. Ils parlèrent des Lettres de la montagne: «J'ai dit à M. Bertrand», nous rapporte DuPeyrou, «que je regardais ce livre comme l'antidote de l'incrédulité, non pour les crédules, mais pour les vrais croyants 5. » Ce sentiment,
reconnaissons-le, n'est pas celui d'un disciple aveugle de Voltaire. Pour plaire au seigneur de Ferney, il eût fallu, à cette date, trouver l'ouvrage détestable.
Mais si DuPeyrou ne se laisse, en aucune façon, manoeuvrer par Voltaire, il se montre, en revanche, très capable de se servir, lorsqu'il le juge bon, du grand homme, de l'écrivain prestigieux, dont le moindre «rogaton» connaît un succès européen. La preuve, c'est, au lendemain de la «lapidation» de Môtiers, le rôle qui fut le sien dans l'élaboration des Questions (ou Lettres) sur les miracles. Le 21 novembre 1765, DuPeyrou annonce à Rousseau, alors à Strasbourg, qu'il a reçu de Genève deux lettres imprimées, «sous le titre de 14e et 15e Lettres à l'occasion des Miracles, par M. Beaudinet, citoyen de Neuchâtel, à M. Covelle, citoyen de Genève». Elles lui ont paru «de la façon de Voltaire», mais il ne sait qui les lui a adressées: «Elles tournent en ridicule tout ce qui s'est passé dans ce pays soit avec Petitpierre, soit avec vous. Le Professeur [c'est Montmollin] et les ministres d'ici et de Genève n'y sont pas épargnés, et nous y sommes tous pour quelque chose. Moi, j'ai supposé que j'étais M. Beaudinet, et j'en ai ri de tout mon coeur 1. » Un mois plus tard, DuPeyrou mande à Rousseau: «Dans la 17e [Lettre], [M. de Voltaire] a jugé à propos de me nommer, mais de façon à ne pas lui en savoir mauvais gré. Voici le passage: «J'oubliais de vous dire qu'on nous demandait hier pourquoi, en certains pays, ... on se moquait souvent des prêtres et qu'on respectait toujours les magistrats; c'est, répondit M. DuPeyrou, qu'on aime les lois et qu'on rit des contes.» Et DuPeyrou d'ajouter: «Ce trait sent un peu le fagot, mais heureusement je ne crains point notre prêtraille... 2 » Passent quelques jours, après lesquels DuPeyrou, disant à quel point Voltaire «s'acharne» sur nos pasteurs «et les mord en dogue anglais», se trouve bien obligé d'avouer que Rousseau, lui aussi, est, dans ces lettres, «par ci par là», l'objet de «quelques hurlades» 3. Jean-Jacques, à Paris, juste à la veille de son départ pour l'Angleterre, s'inquiète. Comment donc? DuPeyrou en relations avec Voltaire: c'est du moins le bruit qui circule. Que doit-il croire? DuPeyrou, le 13 janvier, s'explique enfin:
Je vais vous parler de moi et de M. de V[oltaire]... Je recevais [les Lettres à l'occasion des miracles] sans savoir de qui. Mme Cramer-Delon, que je connais depuis l'année 1757, m'envoya les précédentes, que je lui demandai, et notre
correspondance se réveilla. Comme elle connaît beaucoup V[oltaire}, je profitai de l'occasion pour lui parler de nos lamas et de leurs productions, en y joignant mes remarques, bien sûr que tout cela serait communiqué à l'auteur des Lettres, et c'est ce que je voulais. J'espérais qu'il profiterait de tout cela pour assommer nos prêtres, et cela est arrivé. Outré contre cette race, le ton dont j'en ai parlé dans ma correspondance a persuadé à V[oltaire], avec beaucoup de raison, que je verrais volontiers tous ces gens démasqués et couverts de ridicules 1.
DuPeyrou ajoute qu'à l'envoi de la 18e Lettre était joint un billet signé Misoprist. Ce M. Misoprist, c'est évidemment Voltaire, «l'ennemi des prêtres» (tel est le sens de ce singulier hybride gréco-anglais). DuPeyrou s'écrie encore: «Si je pouvais le voir accabler nos prêtres et vous venger de ces misérables, que je serais content! J'y travaille de tout mon coeur 2. » Ainsi donc, une belle dame, Mme Cramer-Delon, épouse de Gabriel Cramer, l'éditeur genevois de Voltaire, aurait servi, d'abord, d'intermédiaire. DuPeyrou n'aurait envoyé ses renseignements sur nos lamas qu'après la publication des 14e et 15e Lettres, c'est-à-dire des deux lettres traitant de l'affaire Petitpierre et de la «lapidation» de Môtiers. Il aurait, par conséquent, fourni à Voltaire quelques éléments de la 17e Lettre (en particulier, le mot que j'ai cité sur les prêtres et les magistrats) et l'essentiel de la Lettre 19e, «de M. de Montmollin prêtre à M. Needham», lettre féroce, où le pauvre pasteur se voit terriblement malmené. On y lit, Voltaire imaginant de faire parler, ou plutôt écrire, Montmollin lui-même:
Vous saurez, Monsieur, que Jean-Jacques ayant été lapidé, M. DuPeyrou, citoyen de Neuchâtel, a jeté des pierres dans mon jardin; il s'est avisé d'écrire que la lapidation n'est plus en usage dans la nouvelle Loi; que cette cérémonie n'a été connue que des Juifs et que, par conséquent, j'ai eu tort, moi prêtre de la Loi nouvelle, de faire jeter des pierres à Jean-Jacques, qui est de la loi naturelle... M. DuPeyrou a été élevé en Amérique; vous voyez bien qu'il ne peut être instruit des usages de l'Europe. Je compte bien le faire lapider lui-même à la première occasion, pour lui apprendre son catéchisme... On dit qu'on commence à penser dans les rues hautes et dans les rues basses: cela me fait frissonner; nous autres prêtres, nous n'aimons pas que l'on pense. Malheur aux esprits qui s'éclairent; honneur et gloire aux pauvres d'esprit!
Tout cela, certes, est du plus pur Voltaire, du plus éblouissant. Mais peut-être, sans l'intervention de DuPeyrou, cette Lettre n'eût-elle pas été écrite. Rousseau, qui n'avait pas lu encore les Questions sur les miracles,
reprocha à DuPeyrou cette correspondance avec M. Misoprist. Elle s'accordait mal, pensait-il, avec la «sagesse» habituelle de son ami. Et d'ailleurs, lui écrivait-il, «il est au-dessous de vous de vous occuper de ce cuistre de Montmollin et de sa vile séquelle. Oubliez que toute cette canaille existe! 1 » DuPeyrou se rendit enfin aux conseils de Jean-Jacques. La polémique avait assez duré. Il se félicitait cependant de l'avoir, sinon provoquée, du moins entretenue. Le 14 février 1766, il écrivait encore à Rousseau: «Pourvu que les prêtres perdent leur crédit et le pouvoir de nuire à des hommes vertueux et qui font usage de leur raison, je suis content. Ils ont fait assez de mal pour en être punis, et je ne suis pas fâché de voir un de vos ennemis [c'est Voltaire] devenir votre vengeur 2. »
Peut-être trouvera-t-on que je me suis arrêté bien longuement aux rapports de DuPeyrou et de Voltaire, alors que je n'ai fait que de brèves allusions à la Lettre de Goa. Je me justifierai par deux considérations: d'abord que le détail de la Lettre de Goa et des pièces annexes exigerait une étude spéciale —je compte la faire une fois —mais impossible dans les limites de cet exposé; ensuite que l'examen des relations de Voltaire et de DuPeyrou est particulièrement révélateur du comportement que je vois à celui-ci et qui le situe non point sur le plan que je dirais volontiers «local» — celui des seules affaires neuchâteloises et des querelles de clocher — mais sur un plan d'où l'horizon intellectuel apparaît plus large, plus ouvert. La Lettre de Goa fut en quelque sorte, pour DuPeyrou, un accident, une prise de position dans notre vie politique et religieuse neuchâteloise, qui lui valut des ennuis, des ennemis et le mit en butte à la calomnie. Il en conçut non point, je crois, de l'amertume, mais un désabusement que les années et une santé bientôt chancelante devaient peu à peu aggraver. Neuchâtel pouvait bien être le lieu de sa résidence. Il n'était que très peu le lieu de son esprit. Dans sa bibliothèque, ornée de deux bustes de Voltaire, où de plus en plus il se retire, dans le grand salon de compagnie, où un buste et une statue en pied attestent la présence spirituelle de Rousseau et où défilent tant d'hôtes étrangers, DuPeyrou vit dans une société de son choix. Grâce aux livres, grâce à ses visiteurs, il est en contact avec le plus vivant de la pensée européenne, qui est alors, avant tout, une pensée française. Dépositaire des papiers de Rousseau, il demeure le défenseur du Citoyen; il protège sa mémoire des atteintes des détracteurs.
Mais cette fidélité exemplaire à Rousseau ne l'empêche nullement de s'intéresser — et de très près — à d'autres aspects des lettres de son temps. A Marc-Michel Rey, l'éditeur d'Amsterdam, mais Genevois d'origine, DuPeyrou commande de nombreux ouvrages; d'autre part, il lui envoie des livres nouveaux, dont il peut penser que Rey donnera une contrefaçon. Ainsi des Lettres sur les miracles, de ce Recueil nécessaire, où sont réunis quelques-uns des libelles les plus audacieux de Voltaire. Ainsi du Sermon de Josias Rosette: «Je le fais copier pour vous, écrit-il, n'y ayant ici que mon exemplaire, que je tiens de l'auteur lui-même. J'y joindrai L'Homme aux 40 écus 1. » Quant aux commandes faites à Rey, il s'agit parfois d'un seul exemplaire, que DuPeyrou destine à sa bibliothèque; parfois aussi de 50 ou de 100 exemplaires d'un même ouvrage. Dans ce cas, DuPeyrou semble être l'intermédiaire de Fauche, qui distribuait ces livres aux amateurs de Suisse romande. Notons que ces ouvrages sont toujours ou moralement ou philosophiquement libertins.
Je voudrais avoir le temps d'étudier ici, de manière un peu précise, la composition de la bibliothèque de DuPeyrou. Il me faut me borner à quelques remarques. A un fonds solide de dictionnaires de toutes sortes, parmi lesquels Moreri, Bayle, le dictionnaire de Trévoux, l'Encyclopédie de d'Alembert et Diderot, il faut joindre les grammaires de six ou sept langues (notons au passage que DuPeyrou avoue, dans une lettre à Hume, son «ignorance de la langue anglaise...)2, un certain nombre d'ouvrages en latin (mais de plus nombreuses traductions); rien en hollandais, sauf une vieille Bible; rien en allemand. L'Angleterre n'est représentée que par des traductions; en revanche, il semble que DuPeyrou lisait l'italien: il possédait Boccace, la Jérusalem délivrée, dans la langue originale. Pour l'essentiel cependant —et je viens de le laisser entendre — sa culture est française. Il est bien un représentant de cette époque où Rivarol proclamait, en un mémoire couronné par l'Académie de Berlin, «l'universalité de la langue française». Culture, précisons-le, où les sciences de la nature vont de pair avec l'histoire et la politique, comme avec la philosophie et les belles-lettres. En effet, si, parmi les quelque 3000 volumes de sa bibliothèque, plus de 1000 peuvent se classer, plus ou moins, dans une section Littérature, plus de 600 traitent soit de mathématiques, soit de sciences naturelles. Et à cela il faut joindre les relations de voyage et les ouvrages de géographie (avec de nombreux atlas). La section Histoire compte, à elle seule, près de 450 volumes. Je passe,
sans m'arrêter, sur la philosophie du droit, la jurisprudence, la politique: Grotius et Puffendorf sont là, et Montesquieu, et Vattel, Beccaria, Linguet et Brissot. J'en viens aux lectures religieuses et philosophiques de DuPeyrou. La distinction est difficile à faire d'avec la pure littérature, car au XVIIIe siècle il n'est guère d'ouvrage littéraire qui ne soit teinté de «philosophisme». Le rayon des ouvrages religieux n'est certes pas le mieux garni. Bossuet, Fléchier, Mascaron y alignent leurs Oraisons funèbres, Pascal y figure avec les Provinciales (mais non pas les Pensées). Ostervald est présent, avec sa traduction de la Bible et plusieurs de ses traités, et Werenfels, La Placette, de même que Chaillet et Bertrand, pour leurs Sermons. La Liturgie de Neuchâtel complète le rayon. Bien plus nombreux sont les philosophes, Bayle, Locke, Wolff, tout Voltaire, dont un grand nombre d'éditions originales, tout Rousseau, cela va de soi, et les brûlots matérialistes du baron d'Holbach. Je m'étonne cependant de ne pas trouver Diderot. Mais voici Toussaint, l'abbé Raynal, Maupertuis, LaMettrie, sans préjudice de tant d'ouvrages anonymes allant des Lettres chinoises aux Lettres cabalistiques, en passant par l'Alcoran des cordeliers, la Sainte Bible gauloise, Margot la Ravaudeuse, Le Compère Mathieu, Cokanor, La Poupée, Amilek ou la graine des hommes, la Vénus physique, L'Art de faire des garçons et le Tableau de l'amour conjugal. Oui, si la bibliothèque de DuPeyrou nous était conservée, il conviendrait d'en distraire pas mal de volumes pour former un Enfer, brûlant autrefois, mais dont les flammes, aujourd'hui, s'élèvent, assez inoffensives, sur des monceaux de cendres. Quant à la littérature pure, DuPeyrou possédait l'essentiel des grandes oeuvres du XVIIe siècle, et, en particulier, une très importante collection d'auteurs dramatiques et comiques. Du XVIIIe siècle, la plupart des poètes lyriques, aujourd'hui oubliés, et beaucoup de romans, de Lesage et Hamilton à Crébillon.
«La lecture», écrivait-il à Rey, en 1769, «est pour moi une ressource de première nécessité 1. » Et, vingt-quatre ans plus tard, à Mme de Charrière: «Il me faut la solitude; c'est elle qui me fournit des distractions à mon choix..., capables de fixer mon attention intellectuelle d'une manière assez suivie pour assoupir le sentiment des peines 2. » Ses «peines»? — Dès 1765, il en entretenait Rousseau. Pas de soucis financiers: sa fortune était immense: «Mes affaires d'intérêt sont en bon état et beaucoup plus considérables que mon ambition.» Il évaluait sa dépense annuelle de 20 à 24 000 livres; mais il avait, en France, 10000 livres
de rentes; en Suisse, des fonds s'élevant, non compris sa magnifique demeure de Neuchâtel, à 120 ou 130000 livres. Quant à ses plantations de Surinam, une seule (et il en avait trois) lui rapportait «au moins 24000 livres par an» et «quelquefois 40000» 1. Mais il semble que l'administration de ses biens lui pesait: «Mes occupations», écrit-il, «se multiplient avec mes années et j'ai quelquefois grand besoin de fermer les yeux pour ne pas perdre courage et prendre un parti de désespéré 2. » Il lui arrive d'éprouver «un ennui et un dégoût universels 3 ». Tendance évidente à l'hypocondrie. Rousseau le lui dit: «Vous aimez à vous affubler la tête d'un drap mortuaire 4. » Il est vrai qu'une santé physique très tôt délabrée —faut-il en rendre responsables des excès vénériens et une sorte de boulimie contre laquelle Rousseau le met souvent en garde? — explique en partie ces «humeurs noires». Dès l'âge de trente-cinq ans, DuPeyrou se plaint de fréquentes attaques de goutte. Son ouïe s'affaiblit. Il souffre des yeux. En avril 1766, il note: «Je tire à la fin de mon existence..., mes cheveux grisonnent..., mon sang se glace 5. » Il consulte des médecins, chez nous et à l'étranger. Il fait des cures, à Louèche, à Bussang. Il achète des dictionnaires de médecine et d'innombrables traités sur la goutte et les rhumatismes. Pendant des années, il pense trouver une amélioration de sa santé en se baignant, chaque jour, dans notre lac, même au plus froid de l'hiver.
De fin septembre 1768 au printemps 1769, DuPeyrou traversa ce qu'il a qualifié lui-même «une des épreuves les plus terribles de [sa] vie». Sa mère, glissant sur le parquet de sa chambre, s'était cassé le col du fémur. Elle subit plusieurs opérations, mais au cours de l'hiver son état général donna de vives inquiétudes. Elle s'affaiblit peu à peu et mourut au début de mai. Séparation douloureuse, et d'autant plus que ce fils avait, semble-t-il, concentré sur sa vieille maman toutes ses puissances cachées de tendresse et de dévouement. Il les reporta, presque aussitôt, sur la fille de son ami Pury, Henriette-Dorothée. Le mariage eut lieu en juin. Union disproportionnée, mal assortie, je crois pouvoir le dire. Cet homme prématurément vieilli épousait une femme-enfant, très jolie, très vive, naturellement éprise des distractions de la vie mondaine. Elle aimait à recevoir somptueusement: dîners, bals, fêtes sur le lac, promenades en traîneaux. Avec de jeunes amis, il lui arrivait de courir les rues
de Neuchâtel masquée, ou à cheval, peu soucieuse des règlements de police. Dans le théâtre nouvellement bâti, elle brillait parmi des artistes-amateurs, choisis dans la meilleure société de la ville. En 1782, dans le Barbier de Séville, elle jouait Rosine, et son mari don Basile 1. Autour d'elle un groupe d'admirateurs évolue, et elle n'est pas insensible à leur empressement, à leurs hommages. On se bat en duel à cause d'elle, et, bien entendu, tout cela fait jaser. Des enfants, peut-être, eussent fixé les sentiments de cette femme qu'on voit livrée à ses caprices et aux facilités de la richesse. DuPeyrou, écrivant à Rey qui allait devenir grand-père, en 1772, avoue à son correspondant que, «franchement, soit bêtise, soit philosophie», il ne s'affecte « en aucune façon de cette disette d'enfants 2 ». Mais je m'en voudrais d'accabler Mme DuPeyrou. Brissot, le futur Girondin, qui passa un mois à Neuchâtel, en 1782, nous a laissé de celle que Jean-Jacques appelait «l'aimable Henriette» un portrait bienveillant. Il la dit sensible, dévouée aux malheureux, attentive à distraire son mari «par des lectures continuelles». Mais il l'a vue malheureuse, «trop livrée à cette facilité qui accompagne la bonté, la générosité, et que la calomnie travestit ensuite en crime 3 ». Peut-être Brissot a-t-il deviné ce que les familiers du ménage DuPeyrou n'ont pas vu: une jeune femme masquant de frivolité, aux côtés d'un mari sourd et podagre, la secrète tristesse d'un mariage raté. Les années passent et, entre les deux époux, il semble bien que les distances s'accroissent. En 1785, Mme de Charrière écrit à Chambrier d'Oleyres: «On prétend que M. et Mme DuPeyrou ne se parlent plus 4. » Sans doute exagère-t-elle, mais il est certain que DuPeyrou s'enfonce de plus en plus dans la solitude et le silence. La vie mondaine continue cependant. Les hôtes les plus distingués affluent dans le salon des DuPeyrou. La Révolution amènera des émigrés, ainsi ces deux charmants frères, Camille et Pierre Mallarmey de Roussillon, dont le second, «Pierrot», inspira à Mme DuPeyrou un sentiment fort tendre. Mme de Charrière écrit à Chambrier d'Oleyres: «Vous avez peutêtre appris quelque chose des bontés qu'on a pour lui à Neuchâtel 5. » Des bontés: soulignons l'euphémisme et notons encore que la dame du Pontet, qui n'aimait guère Mme DuPeyrou, composa, après la mort du mari, une épigramme où elle n'hésite pas à dire que Thémire (c'est
Mme DuPeyrou) ne songeait qu'au dieu Amour et faisait «de ses autels un très fervent usage 1 ». Ph. Godet affirme que DuPeyrou, «résigné à ces sortes de choses, ne paraît pas en avoir pris ombrage 2 ». Galant homme, il n'en dut pas moins souffrir et je trouve quelque chose de pathétique à cette lettre du 15 octobre 1794, qu'il envoie à Mme de Charrière:
[Le silence], chez moi, n'est pas celui du repos ni du bonheur... J'ignore ce qui se passe, même auprès de ceux que je crois mes amis; ou je n'en suis informé qu'après coup... En un mot, je ne vis que loin des lieux que j'habite et je sais, par malheur, mieux ce qui se passe à cent lieues de moi qu'autour de moi. Je dis par malheur, car il n'y a que des malheurs à apprendre et à prévoir 3.
«Ce qui se passe à cent lieues de lui», DuPeyrou l'apprend par les livres ou dans ses entretiens avec les hôtes étrangers qu'il reçoit. Ainsi Sébastien Mercier, Brissot, Mirabeau; ainsi les Genevois Clavière et DuRoverey; ainsi le général Miranda. A Mirabeau, tout frais sorti des prisons de Pontarlier, DuPeyrou sert d'intermédiaire auprès d'imprimeurs neuchâtelois. La «tierce personne» à qui fut rendu, selon un rapport de police, le manuscrit du pamphlet sur Les lettres de cachet et les prisons d'Etat, après impression clandestine, il est à peu près certain que ce fut DuPeyrou 4. J'incline d'autant plus à le penser qu'au lendemain de sa mort, on trouva dans son bureau «14 paquets imprimés contenant des Lettres de cachet». Cette complaisance de DuPeyrou, cette assistance accordée à des publicistes tels que Brissot ou Mirabeau —bien avant que la politique révolutionnaire ne les ait auréolés de gloire —procèdent-elles uniquement d'une vive curiosité intellectuelle et de cette générosité que tous ceux qui approchèrent DuPeyrou s'accordent à lui reconnaître? Je ne le crois pas. Un lien secret, une sympathie d'autre sorte devait l'unir à certains de ses hôtes. Depuis longtemps la chose n'a cessé de m'intriguer. Je me la suis expliquée en faisant l'hypothèse de l'appartenance de DuPeyrou à la franc-maçonnerie. Hypothèse que je n'appuyais sur rien d'autre que, d'une part, la formule qu'on lit en tête du testament de DuPeyrou: « ... après avoir recommandé mon âme à la bonté de l'Etre suprême, créateur, conservateur et bienfaiteur de tout ce qui existe...», et, d'autre part, ce monument funéraire «dans le style égyptien», dont les deux sphinx (ou leurs copies), à l'entrée du jardin de
l'hôtel DuPeyrou, nous rappellent, aujourd'hui encore, le projet 1. Le sphinx est fréquent parmi les motifs qui décorent, au XVIIIe siècle, sur tant d'images, les édifices maçonniques. Que l'on songe au temple — égyptien aussi — de La Flûte enchantée! Appuis bien fragiles de mon hypothèse, me dira-t-on peut-être. Je l'accorde. Mais voici que l'inventaire du mobilier de DuPeyrou me fournit, sinon la preuve rigoureuse —que seule donnerait un diplôme, une inscription dans un registre, un texte de correspondance — du moins deux indices très sérieux de l'admission de DuPeyrou à la franc-maçonnerie. Parmi les livres de DuPeyrou, je trouve quatre ouvrages, dont l'un surtout est un classique de la franc-maçonnerie française du XVIIIe siècle: Les plus secrets mystères [des hauts grades] de la maçonnerie dévoilés ou la Vraie Rose-Croix (1774). Les trois autres s'intitulent Les secrets de la franc-maçonnerie, L'Ordre des Francs-maçons trahis et Nouveau catéchisme des Francs-maçons. Second indice: «dans le corps du milieu» de la table de travail de DuPeyrou, les commissaires préposés à l'inventaire trouvent et énumèrent divers paquets de lettres concernant Rousseau et, sous le N°215, ils inscrivent le dernier objet qu'ils découvrent: «un tablier de franc-maçon» 2. Il suffit. Dans un livre récent de Roger Priouret, préfacé par Pierre Gaxotte, La Franc-maçonnerie sous les Lys, l'auteur montre que les Loges, à la fin de l'Ancien Régime, «préfigurent» en quelque sorte nos Rotary-clubs, réunis «autour d'une table soignée et dans une atmosphère cordiale...» 3. Il fait voir aussi la franc-maçonnerie favorisant l'impression et l'échange, entre «Frères», de la littérature clandestine: «Les Loges, écrit-il, facilitent de tels échanges, comme elles facilitent les contacts intellectuels 4. » La table, «très soignée» aussi de DuPeyrou, ses brillantes réceptions, ses relations avec tant d'écrivains et d'éditeurs ou libraires, tout cela ne fut-il pas l'occasion de ces échanges et de ces contacts évoqués par Priouret? Je n'hésite plus, quant à moi, à affirmer aujourd'hui le rôle — et sans doute fut-il important — de DuPeyrou franc-maçon.
Il «n'aimait pas l'Ancien Régime 5 » —il l'affirme à Mme de Charrière, en 1793. Il vit, avec plaisir l'ouverture des Etats-Généraux, en
mai 1789. Il devait, alors, partager les idées libérales de M. et Mme de Charrière. Mais, dès le 23 juin et la Déclaration royale, DuPeyrou se range du côté du roi, contre le Tiers-Etat. La suite précipitée des événements ne fait que renforcer, avec ses inquiétudes, son pessimisme. Il s'étonne que ses amis de Colombier puissent conserver, en face de la Révolution, «une sécurité que rien n'ébranle». Pour lui, il n'est sûr que d'une chose: «la Révolution française finira par une cacade complète 1. » Ce Necker, qui, en somme, lui est sympathique, pourquoi donc ne «casset-il pas les vitres.., en abandonnant sa place? Quand il prendra ce parti, il sera trop tard 2. » Quant aux travaux législatifs de la Constituante, DuPeyrou les juge avec un scepticisme désabusé: «Je crois impossible de faire une bonne Constitution..., si plusieurs hommes y sont appelés... 3 » De mois en mois, année après année, son pessimisme s'accroît. La guerre en Hollande, le bouleversement des provinces françaises lui créent des soucis financiers, des angoisses familiales. Au moment de la lutte entre Montagnards et Girondins, il écrit: «Je suis porté à croire que l'homme doit, comme le boeuf ou le taureau, pour être utile et maniable, être sous le joug. J'en suis fâché pour l'espèce, et c'est pour cela que je rougis d'en être 4. » Au moment où la Convention institue le Tribunal révolutionnaire, que penser de ce publiciste parisien qui a le front d'écrire: «Les étrangers viennent chercher en France les biens inestimables de l'égalité et d'un système social épuré! 5 » Les émigrés? DuPeyrou s'emploie pour eux sans compter, mais il les juge sévèrement:
L'émigration française, dans son principe, m'a fait grand mal au coeur, comme mesure impolitique et lâche tout à la fois dans ceux qui en ont donné l'exemple. Ensuite, le coeur m'a soulevé tout à fait, à la conduite des émigrés en général et d'un grand nombre surtout d'entre eux qui, non seulement n'ont rien fait pour leur cause, mais ont nui à ceux qui voulaient faire 6.
En définitive, c'est à une vue de l'absurdité radicale de l'événement que DuPeyrou se trouve conduit: «Il n'y a plus rien d'absurde à rejeter comme tel, depuis que la Révolution nous y a acclimatés 7. » «L'absurde, dit-il encore, sera toujours le lot du genre humain 8. » Ambition et
lâcheté, «immoralité générale et sottise particulière»: devant un tel spectacle, DuPeyrou en arrive à se dire « assez indifférent sur les événements politiques»: «Puisqu'il y a un terme à tout et qu'il ne peut être question que de quelques jours de plus ou de moins à ce terme commun, la différence ne vaut pas assez pour s'en tourmenter.» Ces lignes à Mme de Charrière sont du 29 août 1794. Ce «terme», deux mois et demi plus tard, DuPeyrou y atteignait. Au lendemain d'une visite à son amie de Colombier, il mourait, frappé d'une congestion, au cours d'un dîner qu'il offrait à quelques amis. Ecrivant, le surlendemain, à Mme de Sandoz-Rollin, Mme de Charrière s'exprime ainsi: «Je ne suis pas étonnée de sa mort si prompte et si douce. La mort avait peu à faire... 1 ». Et quelques jours plus tard, à Chambrier d'Oleyres: «Riche, [M. DuPeyrou] n'en fut pas moins simple ni moins bienfaisant; souvent trompé, il n'en devint pas plus capable de défiance; et, tourmenté, affligé dans ses relations les plus chères, sa douceur ne s'altéra pas... Sa mort est moins affligeante que le souvenir de sa vie n'est doux, et je parlerai de lui avec plaisir tout le temps qui me reste à vivre 2. » Cet hommage rendu à DuPeyrou par la personne qui, peut-être, le connut le mieux, ayant eu la confidence de beaucoup de ses plus secrètes pensées, il n'est rien, au terme de cette étude, que je veuille y changer. A mon tour, je me suis plu au souvenir de cette vie, où la bienfaisance sut s'allier à la curiosité intellectuelle et au courage de l'esprit, où les peines ne firent qu'aviver les dispositions d'un coeur généreux. J'ai «parlé de lui avec plaisir». Puisse-t-on m'avoir entendu sans ennui!







