INSTALLATION DE
MONSIEUR LE RECTEUR
DOMINIQUE RIVIER
ET DE
MESSIEURS LES VICE-RECTEURS
M.-H. AMSLER ET J.-C. BIAUDET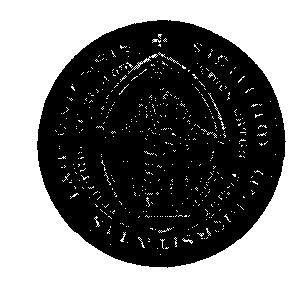
LIBRAIRIE PAYOT
LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ
LAUSANNE 1969
DISCOURS
DE M. LE PROFESSEUR DOMINIQUE RIVIER
RECTEUR ENTRANT EN CHARGE
Monsieur le Conseiller d'Etat,
II y a deux ans, en cette même aula, lors de l'installation du
recteur Mauris, vous avez fait sensation et, du même coup, vous
avez donné les plus grands espoirs à notre Université.
Pour la première fois dans l'histoire de notre Ecole, le chef du
Département de l'instruction publique et des cultes rompait une
lance en faveur de l'autonomie de l'Université, faisant de celle-là
le thème majeur de son discours. Et votre propos paraissait clair:
loin de ramener cette autonomie à je ne sais quelles justes proportions
qui l'auraient anéantie, vous la saluiez au contraire comme
un bienfait à conquérir, la recommandant — sans trop d'illusion
il est vrai — aux bons soins des professeurs qui vous écoutaient,
surpris et réjouis tout à la fois.
Depuis lors, l'expression «autonomie de l'Université» a fait
fortune. En deçà comme au-delà du Jura, tout le monde en parle,
tout le monde est pour, du plus petit jusqu'au plus grand... vous
m'avez compris, je pense!
Que de malentendus pourtant à son sujet. Droit de l'Université
à se gouverner elle-même, responsabilité pour elle d'établir et de
gérer son budget, liberté politique intérieure face aux pouvoirs
publics, indépendance financière... autant d'auteurs, autant d'acceptions
différentes dont la multiplicité finit par discréditer jusqu'à
l'Université même.
C'est pourquoi au moment où, vigoureusement encouragée par
vous, Monsieur le Conseiller d'Etat, l'Université s'engage dans les
voies de l'autonomie, il n'est pas mauvais qu'après vous et par le
truchement du rectorat, elle fasse connaître ses vues sur un point
d'aussi décisive importance.
Une remarque préalable paraît nécessaire. Plutôt que de droits,
l'autonomie de l'Université est bien davantage faite de responsabilités
et d'obligations: responsabilités envers l'Etat et le pays,
bien sûr, mais aussi, et à travers eux, obligations envers la société.
Quant à ces responsabilités, les voici: façonner la politique intérieure
de l'Université, préparer son plan de développement en le
coordonnant avec ceux des hautes écoles soeurs du pays. Puis, en
fonction de cette politique, ordonner le budget, le présenter aux
pouvoirs publics, le défendre face à d'autres clients et, le cas échéant,
l'ajuster aux décisions de l'Etat. Enfin, appliquer la politique choisie,
notamment dans une attentive exploitation du budget.
Belle perspective en vérité que l'exercice de cette autonomie!
Seulement voici: la plus exaltante des missions n'est en définitive
qu'un poids insupportable à qui la reçoit si des moyens proportionnés
ne sont pas simultanément offerts.
Aussi bien, l'instauration du rectorat que vous installez aujourd'hui,
Monsieur le Conseiller d'Etat, constituait dans les faits le
premier pas, à la fois nécessaire et capital, de cette mise de moyens
à disposition de l'Université. Celle-ci est très reconnaissante au
gouvernement de l'avoir franchi si rapidement. Mais le pas ne
saurait être que très court, et au surplus d'efficacité douteuse, s'il
n'était suivi de la rapide installation de l'appareil administratif
indispensable à la conduite de l'Université. Nous voulons croire
que le Conseil d'Etat, à ce jour pleinement informé de l'urgente
nécessité qu'il y a de doter l'Université d'une administration appropriée
— et cela préalablement à toute réforme, précisément parce
que ces réformes ne seront pas possibles sans cette administration —
nous voulons croire que le Conseil d'Etat donnera bientôt au
rectorat, et par lui aux facultés et aux écoles, aux professeurs, aux
assistants et aux étudiants, les moyens indispensables à l'accomplissement
des multiples tâches, anciennes et nouvelles, qui seront
assignées à l'Université.
Est-il admissible de voir aujourd'hui encore, au temps de la
recherche opérationnelle et des ordinateurs, est-il admissible de
voir des doyens procéder eux-mêmes à de laborieuses répartitions
de finances d'examens, des présidents passer des heures d'horloge
à combiner des horaires, des directeurs courir les gérances et, le
mètre à la main, jouer les aides-architectes, ou enfin des professeurs
déserter la recherche pour remplir des questionnaires parfois utiles
mais toujours indigestes? N'est-il pas temps que, dans notre
vénérable maison, l'on cesse une fois pour toutes, selon le mot de
La Bruyère, de «scier avec un rabot afin de mieux raboter avec
une scie?»
Car le temps presse... Après la très pénible rentrée de l'automne
1967, celle que nous venons de vivre a été dramatique et
mouvementée. Tout porte à croire que l'an prochain plus d'une
faculté et plus d'une promotion se trouveront en posture plus
critique encore si des mesures efficaces ne sont pas prises dans les
délais les plus brefs. Or, tant pour discerner ces mesures que
pour les exécuter, il faut un appareil administratif auprès duquel
ce qui existe à l'Université n'est que pure dérision!
Monsieur le Recteur sortant de charge,
C'est au début d'une période particulièrement bien remplie que
vous avez accepté la responsabilité de gouverner la barque universitaire:
aide fédérale aux universités, transfert des facultés à
Dorigny, réorganisation de l'Université, réveil des étudiants...
autant de problèmes dont chacun, à lui seul, eût pleinement suffi
au bonheur du recteur le plus exigeant! Combien ingrate fut votre
tâche! Faire accepter à notre gouvernement —justement barricadé
derrière des consignes draconiennes de plus stricte économie —les
requêtes innombrables et réitérées d'une Université en mal aigu
de développement, avec cette circonstance aggravante d'une disparité
criante dans les moyens de communication: l'un des interlocuteurs
usant généreusement du verbe, l'autre mettant toute sa
confiance dans la multiplicité de lettres savamment groupées en
trains toujours bien partis, mais rarement revenus.
Qu'importe, animé d'une évangélique ardeur, déployant sans
cesse vos qualités d'homme de devoir et de paix, vous avez inlassablement
accepté de passer de l'Université à l'Etat et de l'Etat à
l'Université, soucieux de garder toujours ouvert un dialogue qui,
maintes fois, aurait pu sans vous tourner court.
L'Université vous remercie de tous les efforts généreux que
vous avez consentis à son endroit. Quant au rectorat, il se réjouit
à la pensée de pouvoir, longtemps encore, compter sur vos conseils
dévoués et compétents au sein des divers comités et commissions
auxquels vous appartenez.
Monsieur le Président de l'Union des étudiants
lausannois,
Si Paris et sa grand-ville ont vécu les événements de mai, nous
avons eu, nous à Lausanne, nos journées d'octobre. A peine
était-il en place que, précipité dans le no man's land du numerus
clausus, le rectorat s'est vu saisi d'un mandat destiné, dans les
apparences en tous les cas, à l'opposer aux étudiants. Nulle surprise,
Monsieur le Président, que le rectorat vous ait d'emblée
trouvé sur son chemin.
Aussi pouvons-nous maintenant nous dispenser de sacrifier
trop longuement à l'usage suivant lequel, en ce jour d'installation,
le président de l'Union des étudiants lausannois et le recteur sont
tenus d'échanger félicitations, voeux et compliments. Ces compliments
— n'est-il pas vrai — nous les avons échangés déjà sur les
dernières marches de l'escalier d'honneur du château Saint-Maire,
un certain mardi 12 novembre à onze heures quinze du matin,
sous l'oeil à la fois inquisiteur et inquiet de l'huissier du Conseil
d'Etat!
Ainsi, ce sont les événements qui, sans façons, nous ont obligés
d'engager le dialogue, nous forçant à chercher ensemble, tantôt en
adversaires, tantôt en alliés, des remèdes concrets à la situation
inquiétante dans laquelle la rentrée de cet automne avait placé non
seulement de futurs étudiants, mais aussi des professeurs et leurs
assistants.
Certes — et le rectorat le sait mieux que personne —les problèmes
à venir seront d'une autre portée, les enjeux d'un autre
poids et les positions prises autrement éloignées que cela fut le
cas durant ce dernier mois d'octobre.
Qu'importe, une manière de confrontation — ou de collaboration
si vous le préférez — a été inaugurée, et le rectorat se plaît.
à reconnaître qu'elle a été utile et qu'elle autorise l'optimisme.
Mesdemoiselles les étudiantes,
Messieurs les étudiants,
Le rectorat décevrait votre attente — et probablement celle de
beaucoup de nos hôtes dans cette salle —si je n'abordais pas maintenant,
ne serait-ce que pour un court instant, le thème de ce
que l'on appelle la participation des étudiants. Il en est de cette
expression comme de l'autonomie de l'Université: chacun y va de
sa glose —plus ou moins inspirée selon que le mot éveille de
vastes espoirs ou, au contraire, fait sourdre les craintes les plus
irraisonnées. Aussi la confusion tend-elle à s'installer. Pour cette
raison, et pour d'autres encore, il faut préférer à participation les
termes d'association des étudiants aux responsabilités dans l'Université.
A l'origine, l'Université était une communauté de maîtres et de
disciples. Le pullulement et la divergence des savoirs comme aussi
l'accroissement du nombre des étudiants ont peu à peu transformé
cette communauté en un vaste ensemble, composé de trois corps
distincts et parfois distants: les professeurs, les étudiants et le
corps intermédiaire des assistants (chefs de travaux, chargés de
cours, privat-docents et chercheurs, jeunes et moins jeunes), tiers
état dont le poids relatif n'a cessé de croître ces dernières décennies
*.
Jusqu'à ce jour, la cohésion de l'Université —condition nécessaire
à son développement comme à l'accomplissement de sa mission
— la cohésion de l'Université était le résultat d'un accord
tacite passé entre ses membres. Selon cet accord, il appartient aux
professeurs de prendre les larges responsabilités et d'exercer le
mince pouvoir consentis par l'Etat à l'Université.
Les événements de mai et juin derniers ont enfin fait apparaître
une nécessité que d'aucuns —aussi bien parmi les professeurs que
chez les assistants et les étudiants —avaient reconnue depuis longtemps.
Celle de reprendre à la fois les considérants et les clauses
de cet accord.
De toute évidence, cette reprise est étroitement liée à une autre,
non moins urgente, celle des structures de l'Université. A Lausanne,
les réponses aux questions ainsi posées ne sauraient être
recherchées que dans le cadre de la révision —à peine amorcée —
de la loi sur l'enseignement supérieur. En effet, à la réserve d'utiles
expériences limitées et momentanées, tout essai hâtif de faire accéder
officiellement les étudiants et les assistants aux responsabilités dans
le cadre des anciennes structures —solution par trop simpliste, du
genre de celles récemment adoptées dans plusieurs universités
d'Outre-Rhin par exemple — ne saurait conduire en définitive qu'à
des mécomptes: on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles
outres. Il serait d'ailleurs tout aussi malheureux de vouloir appliquer
de façon primaire à l'Université de Lausanne certaines solutions,
retenues du seul fait qu'elles ont été reçues à Paris, à Rome
ou à Berlin. La situation et l'environnement particuliers à notre
Université sont ici déterminants.
Mais cela ne veut pas dire, Mesdemoiselles les étudiantes et
Messieurs les étudiants, que le rectorat tienne à conserver de
vieilles outres et que votre association aux responsabilités dans
l'Université doive attendre jusqu'aux calendes grecques la mise en
application de la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur. Bien au
contraire.
Cette association des étudiants et des assistants peut s'envisager
aux trois niveaux de l'information, de la consultation et de la
décision. Elle peut intervenir aussi dans de nombreux secteurs,
allant de l'enseignement proprement dit —méthodes ou contrôles
—jusqu'à l'administration de l'Université, en passant par les sports,
les affaires sociales et les relations extérieures. Cette double multiplicité
des niveaux et des secteurs démontre clairement la grande
variété des problèmes à résoudre et la lourde tâche qui attend le
législateur: non seulement la collaboration active des étudiants et
des assistants est souhaitable, mais elle est aussi nécessaire.
Et c'est tout de suite qu'il faut se mettre à l'ouvrage. Or, dans
l'intention de préparer la révision prochaine de la loi, le rectorat a
distingué un certain nombre de problèmes importants dont il vient de
confier l'étude préliminaire à la Commission de prospective de l'Université.
Il importe que sans retard les étudiants et les assistants soient
étroitement associés à ces travaux, sous une forme à préciser d'entente
avec tous les intéressés. C'est d'ailleurs avec la volonté d'encourager
cet effort que le rectorat a décidé, à la demande du bureau
de l'Association générale des étudiants, d'inscrire à l'horaire du prochain
semestre d'été deux heures hebdomadaires réservées dans toute
l'Université à cet énorme travail de réflexion. Le rectorat attend beaucoup
de ce premier exercice d'association sur un cas concret, précis
et d'importance, un exercice témoin qui devrait permettre à tous
d'utiles expériences.
Comme vous le voyez, Mesdemoiselles les étudiantes et Messieurs
les étudiants, le rectorat désire vous faire participer, pleinement
et sans attendre, aux travaux qui permettront de préciser, à
l'intention de l'Etat, ce que devront être les structures de la nouvelle
Université, des structures adaptées à ses lourdes et multiples
tâches.
Mais cette collaboration est soumise à une condition: le rectorat
veut avoir la certitude de travailler avec des hommes dévoués
à leurs compagnons, à leurs collègues et à leur Université plutôt
qu'à des idéologies. Il veut aussi pouvoir compter sur des collaborateurs
résolus à édifier une meilleure université pour demain,
dans l'intérêt général du pays. Mais le rectorat n'a pas l'intention
de rechercher indéfiniment le dialogue avec de permanents contesteurs,
préoccupés surtout de détruire l'université d'hier ou la société
d'aujourd'hui.
Admis dès longtemps dans ce canton, le jeu de la démocratie
connaît certaines règles. L'une d'entre elles veut que les décisions
prises par les représentants du peuple dans son ensemble limitent les
dispositions arrêtées (démocratiquement ou non) dans certains secteurs
ou par certaines institutions du pays.
L'Université constitue l'une de ces institutions: si éminente que
soit sa place, elle doit accepter de voir les dispositions qui la régissent
soumises en dernier ressort au peuple ou à ses représentants dûment
élus. C'est là une limitation fondamentale à l'autonomie de l'Université
dont nous devrions tous, étudiants, assistants et professeurs,
savoir rapidement tirer les conséquences. Car elles sont de poids.
Messieurs les membres du Sénat, mes chers collègues,
Le très agréable devoir de témoigner ici de l'allégeance de
l'Université envers l'Etat, de dire sa reconnaissance au recteur sortant
de charge et de saluer le président de l'Union des étudiants
lausannois, vient de fournir au porte-parole du rectorat l'occasion
d'aborder —fort rapidement il est vrai —quelques points importants
de la vie de notre maison. A première vue, le prétexte paraît
excellent de poursuivre maintenant sur ce thème; peut-être certains
d'entre vous s'attendent-ils même à m'entendre prononcer je ne
sais quel «discours du trône» où seraient tracées les grandes
lignes de la politique que désire suivre le rectorat cette année
prochaine.
En dépit des bonnes raisons qui justifieraient une telle innovation,
le rectorat a estimé préférable pour le moment, de limiter
au plus juste ses déclarations touchant la politique universitaire:
trop d'éléments d'information lui font encore défaut —désigné il
n'y a pas cinq mois, le rectorat n'est entré en fonction que le 15
octobre dernier —trop d'éléments lui font encore défaut maintenant
pour apprécier clairement la situation dans son ensemble. Par
ailleurs, soucieux de divertir les hôtes de l'Université en ce jour
solennel, le rectorat a jugé que trois discours traitant tous de la vie
universitaire devaient suffire et qu'au surplus il n'était pas mauvais
de rappeler hic et nunc que la tâche spécifique de l'Université
restait l'enseignement et la recherche.
C'est pourquoi, abandonnant pour un temps les soucis et les
séductions de l'autonomie ou de la participation, j'en viens maintenant
à des réflexions d'un tour plus personnel touchant un monde
auquel j'ai voué passionnément une grande partie de mon existence:
le monde de la physique.
Mesdames, Messieurs,
Au sens où la physique est entendue à ce jour, cette discipline
est née à Pise lorsque Galilée y entreprit ses célèbres recherches
sur la chute des corps. Malgré leur nombre et leur diversité, les
contributions des Chaldéens et des anciens Grecs à l'astronomie ou
à la mécanique sont restées trop fragiles et trop incertaines, parfois
même trop enserrées dans leur gangue métaphysique, pour influer
sur les développements ultérieurs de la physique.
A deux exceptions près pourtant. La première est bien connue:
même nos écoliers savent que la physique a retenu d'Archimède
plusieurs propositions — dont le fameux principe d'hydrostatique
découvert à l'ombre du palais du roi Hiéron de Syracuse. Le
second apport exceptionnel de l'Antiquité à la physique est à ce
jour souvent ignoré: fait surprenant d'ailleurs, il paraît intéresser
les mathématiciens et les philosophes bien plus que les physiciens
eux-mêmes. Il s'agit des célèbres apories de Zénon d'Elée sur
l'espace, le temps et le mouvement. Aristote avait déjà manifesté la
plus grande admiration pour ces arguments subtils, de nature à la fois
physique et métaphysique, par lesquels, en réponse à une même
question, deux propositions contraires également raisonnées sont
mises en présence. La première de ces apories — celle qui met en
cause le pauvre Achille désespérément à la poursuite de sa tortue
— a cessé de mystifier même les philosophes le jour où les mathématiciens
eurent précisé les conditions dans lesquelles la somme
d'un nombre infini de termes évanouissants prend un sens. Quant
à la seconde aporie du disciple de Parménide intéressant la
physique, elle met en évidence la contradiction apparemment liée à
toute localisation du mouvement: un objet —la flèche de Zénon —
ne saurait occuper de l'espace un point bien défini et, dans le
même instant, se trouver en mouvement.
Il est heureux que — sciemment ou non —les fondateurs de la
cinématique moderne aient ignoré cette aporie lorsqu'ils imposèrent
la notion de trajectoire: l'expérience de la vie courante leur
a d'ailleurs donné raison, qui permet parfois de matérialiser la ligne
de l'espace suivie par un mobile. N'empêche que la difficulté attachée
par Zénon à la localisation du mouvement est bien inopinément
réapparue lorsque — c'était il y a une cinquantaine d'années —
il s'est agi pour les physiciens de se faire une image du mouvement
interne des systèmes atomiques. A leur propos, l'expérience —elle
encore — a indirectement confirmé les vues de celui qu'Aristote
appelait le père de la Dialectique. C'est ainsi qu'à la suite des
pénétrantes analyses de Bohr et d'Heisenberg il a bien fallu renoncer
au concept de trajectoire pour se contenter de probabilités antagonistes
de localisation et de mouvement. Il n'est d'ailleurs pas sans
intérêt de remarquer qu'au moment même où, avec un retard de
deux mille quatre cents ans, Zénon marquait un point contre les
pytagoriciens, ceux-ci prenaient largement leur revanche: la doctrine
du nombre entier servant de fondement à la réalité se trouvait
confirmée de façon tout à fait inattendue dans la description des
états liés d'un système atomique: on sait en effet qu'à ces états,
la physique quantique associe, précisément et de façon biunivoque,
un complexe de nombres entiers ou demi-entiers.
L'intention des brèves réflexions à venir est de signaler que la
physique moderne connaît elle aussi ses apories, et que leur caractère
parfois fondamental devrait être de nature à tempérer quelque
peu l'enthousiasme de ceux qui sont prêts à faire de cette science
une théorie achevée. Il apparaît en effet que les succès les plus
spectaculaires des sciences physiques, aussi bien dans le domaine
conceptuel que sur le plan de la technique, ont été parfois obtenus
au prix de durs abandons dont certains, portant sur l'essentiel, vont
jusqu'à remettre en question les bases mêmes de l'intuition physicienne.
D'où ces apories modernes, souvent gênantes, auprès desquelles
il vaut la peine, semble-t-il, de s'arrêter quelques instants.
Afin de donner leur cadre aux propos qui vont suivre, il est bon
de rappeler quelques-unes parmi les plus importantes des étapes du
développement de la physique, partie dès ses origines à la conquête
de la Nature.
En assignant le premier au temps-durée le rôle de grandeur
physique fondamentale, Galilée ouvre enfin à la science le chemin
qu'elle cherchait depuis plusieurs siècles.
A peine cinquante ans plus tard, Newton fait mieux encore. Il
ne se contente pas de définir à la physique son cadre —l'espacetemps
— ni encore d'en poser les sûrs fondements —l'expérience
et l'expérimentation. Animé d'une intuition de visionnaire, il
impose à la physique son langage définitif —les mathématiques —
et lui donne sa méthode, cette démarche pendulaire oscillant sans
cesse du concret à l'abstrait par les voies contraires de la déduction
et de l'induction. Enfin, dans les Principia mathematica philosophiae
naturalis, un ouvrage qui place son auteur au rang des plus grands
esprits de l'Histoire, Newton apporte, sous une forme déjà parfaite,
la première théorie physique. Fondée sur des axiomes très simples,
guidée par des raisonnements limpides et menant à d'éclatantes
confirmations expérimentales, cette théorie propose une synthèse
saisissante des connaissances en astronomie et en mécanique de
la fin du XVIIe siècle. Du même coup se trouve tendue la robuste
trame sur laquelle va pouvoir se développer vigoureusement toute
la physique jusqu'au début de ce siècle.
Entre-temps, Ampère et Faraday mettent en évidence puis
ordonnent les multiples phénomènes du magnétisme et de l'électricité,
tandis que de leur côté Young et Fresnel découvrent les
mille et une faces bigarrées de l'optique ondulatoire.
C'est alors que, digne successeur de Newton, Maxwell réussit
la synthèse inattendue de l'électromagnétisme et de toute l'optique.
Dans un mémoire d'une grande beauté —«War es ein Gott der
diese Zeilen schrieb», s'exclame Boltzmann enthousiasmé — le
maître au Trinity College de Cambridge substitue à la notion
intuitive, mais fragile et encombrante, de force instantanée à distance
celle beaucoup plus élaborée de champ physique, perturbation
médiate affectant jusqu'au vide — un concept dont toute la physique
fera jusqu'à ce jour l'usage le plus efficace et le plus étendu.
Mais la marche de la physique vers la synthèse ne cesse de
gagner du terrain. Contemporain de Maxwell, Boltzmann montre
en effet comment la thermodynamique, science de la chaleur et de
la température, peut se fonder sur la Mécanique. Grâce à sa pénétrante
analyse statistique des systèmes microscopiques, l'auteur des
célèbres Vorlesungen über Gastheorie réussit à expliquer les grands
principes de la thermodynamique auxquels Clausius vient de
donner une forme claire. C'est le cas notamment du principe qui
affirme l'irréversibilité des phénomènes naturels ou, si l'on veut,
qui donne au temps sa flèche: Fugit irreparabile tempus. Boltzmann
démontre comment ces principes ne sont que l'émergence à l'échelle
humaine de lois moyennes, ces lois régissant un grand nombre de
microcosmes — comme les molécules — et ressortissant à la Mécanique
seule. Il est vrai que les conclusions de Boltzmann reposent
sur une hypothèse — celle de l'existence des atomes et des molécules
—et cette hypothèse est loin d'être alors généralement reçue!
Toutefois, en ce début du XXe siècle, la physique a bien d'autres
soucis. Une irritante difficulté absorbe à ce moment l'attention de
a plupart de ses théoriciens. Tout se passe comme si la lumière —
pourtant analysée de façon irréfutable en un couple ondulatoire de
champs électrique et magnétique — tout se passe comme si la
lumière échappait aux lois les plus élémentaires de la cinématique,
remettant en question la brillante synthèse de Maxwell.
Survient alors Einstein: pour sortir la physique de l'impasse,
il n'hésite pas à renverser certaines des notions les mieux assises.
Ainsi, cet implicite axiome, évidence pour le sens commun, que
la longueur d'un mètre posé sur notre sol ou la durée d'une
seconde battue par une horloge terrestre mesurent constamment
un mètre ou une seconde, peu importe le mouvement de leurs observateurs,
qu'ils soient sur la Terre, sur la Lune, sur Sinus ou même
sur Andromède.
Einstein n'en a cure, qui substitue à ce fallacieux truisme une
proposition à la fois plus simple et rendant mieux compte de la
réalité expérimentale, si contraire soit-elle à l'intuition: quelle qu'en
soit l'origine, quel qu'en soit l'observateur, la lumière se propage
dans toutes les directions avec la même vitesse. Et voilà, sur ce
principe, fondée d'un coup toute la théorie de la relativité!
On sait les conséquences, fécondes et dramatiques, de ce saut
axiomatique: synthèse inespérée de la mécanique avec l'électromagnétisme
et l'optique, progrès décisifs dans l'explication des
phénomènes atomiques... mais aussi, quarante ans plus tard, la
catastrophe nucléaire d'Hiroshima.
D'ici là et sans désemparer, la physique poursuit ses conquêtes.
Afin de rendre compte des multiples propriétés des systèmes atomiques,
propriétés qui depuis plus de vingt ans défient la sagacité
des physiciens, Bohr, de Broglie, Schroedinger et Heisenberg édifient
ensemble la nouvelle théorie qui doit permettre de décrire
les édifices microscopiques: c'est la physique quantique. Il s'agit
d'une patiente mise au point, fondée sur une nouvelle analyse,
très détaillée, du processus de la mesure, analyse qui dénonce
d'abord, pour l'exploiter ensuite, l'inéluctable lien établi par l'observateur
entre lui-même et le système objet de son intérêt.
Et de nouveau, les succès sont aussi foudroyants que spectaculaires:
ce n'est pas seulement l'insondable empire des atomes qui
ouvre ses portes à la nouvelle Mécanique, mais conséquence imprévisible,
c'est toute la Chimie qui se découvre brusquement annexée
par la Physique atomique.
Ainsi le tableau de Mendeléef et ses passionnants mystères sont
en quelque sorte exorcisés: ils ne constituent plus qu'un catalogue
—d'une complexité admirable il est vrai —des innombrables propriétés
attachées aux solutions stationnaires de l'équation du mouvement°
des atomes, farandoles d'électrons tournoyant sans cesse
autour d'un centre de permanent attrait, le noyau.
Mais laissons les atomistes à leur microcosme et à la faune sans
cesse croissante des particules fondamentales pour nous tourner
vers la cosmologie, une des plus prestigieuses conquêtes de la
science moderne. Cette fois, l'appétit de la physique ne connaît
plus de bornes, car c'est bien à tout l'univers qu'elle s'en
prend, repoussant jusqu'aux extrémités du monde les frontières de
son empire.
S'appuyant d'une part sur la mise en évidence expérimentale
et analytique des grandes structures de l'Univers — amas
d'étoiles, galaxies, amas de galaxies — et d'autre part sur les vues
profondes d'Einstein réduisant, dans sa théorie de la relativité générale,
le champ gravifique à une simple déformation de l'espacetemps,
les physiciens sont à même d'offrir à ce jour une véritable
théorie du Cosmos. C'est ainsi qu'ils le décrivent comme le bouquet
final d'un gigantesque feu d'artifice dont la fusée aurait éclaté il y
a dix milliards d'années environ, au moment même où toute
l'énergie de l'Univers — matérielle et lumineuse — devait être
concentrée dans une seule masse de densité fantastique, l'atome
primitif. Selon certains savants, on serait aujourd'hui parvenu à
déceler, perdus dans les espaces interstellaires, les derniers échos lumineux
de cette explosion, trace fugitive du rayonnement formidable
que ce cataclysme avait alors déclenché au sein du noyau origine.
Ainsi, réalisant le plus ambitieux des rêves des philosophes
et mathématiciens de l'Antiquité, les physiciens modernes sont
à ce jour parvenus à ordonner jusqu'à l'Univers lui-même!
A quel prix toutes ces prodigieuses conquêtes de la physique?
C'est pour répondre à cette question que je vous propose maintenant
de nous arrêter à trois de ces difficultés fondamentales —trois
de ces apories, pour reprendre le terme de Zénon — dont la
physique, toujours en marche vers de nouvelles conquêtes, a
chargé sans trop de scrupules une bonne part de ses théories.
La première concerne la théorie de la relativité restreinte. A la
base de toute la dialectique d'Einstein se trouve, on le sait, la notion
de référentiel cartésien, c'est-à-dire la combinaison d'une horloge et
d'un système de coordonnées dans l'espace. La réalisation la plus simple
d'un tel système est, rappelons-le, constituée par trois plans indéformables,
deux à deux perpendiculaires et pourvus de réseaux
métriques pour la mesure des distances. La condition d'indéformabilité
est ici capitale: bien plus que la précision, elle donne à
ces mesures leur sens. Or, mis en mouvement par une force appliquée,
un plan indéformable se déplace d'un bloc: tout se passe
comme si les effets de la force s'y propageaient avec une vitesse
infinie, contrairement à l'un des corollaires les plus importants du
principe d'Einstein, corollaire selon lequel précisément de tels effets
ne sauraient se déplacer plus vite que la lumière. Le corps indéformable
n'a pas sa place en théorie de la relativité: le référentiel
cartésien non plus.
Ainsi, initialement fondée sur la métrologie de la mécanique
newtonienne, et notamment sur l'existence de solides indéformables,
la théorie de la relativité conduit à en nier l'existence.
Les méritoires — mais peu convaincants — efforts entrepris pour
tourner la difficulté, notamment en remplaçant les mesures de
distances par des mesures de temps —c'est la méthode du radar —
ne sont pas parvenus à dissiper un malaise logique dont le caractère
fondamental n'est en aucune façon atténué par les prodigieuses
réussites de la relativité, tant dans le domaine conceptuel que sur
le plan de l'expérience.
La deuxième difficulté dont il faut parler maintenant a trait à
cette autre extension de la physique newtonienne que constitue la
mécanique quantique. Comme il a été rappelé tout à l'heure, cette
théorie, fondée sur l'examen approfondi du processus de la mesure,
arrive à la conclusion que voici: un observateur ne peut tirer
d'information d'un système microscopique sans le perturber, si peu
que ce soit. C'est dire qu'un système sur lequel s'effectue une
mesure subit une action de l'extérieur, action sans laquelle la
mesure elle-même est impossible. Par ailleurs, tributaires en cela de
la théorie newtonienne, les équations du mouvement de la
mécanique quantique et la fameuse équation de Schroedinger
notamment, sont valables seulement lorsque le système, si complexe
et si étendu soit-il, est coupé de toute action extérieure. Ainsi,
très paradoxalement, la physique quantique se trouve à ce jour dans
l'impossibilité de décrire l'évolution des processus dont, précisément,
l'existence lui sert à la fois de fondement et de pierre de
touche. II s'agit là encore d'une difficulté de poids, vraisemblablement
liée aux obstacles quasi insurmontables que rencontrent à
ce jour les physiciens des hautes énergies, ces savants si précieux
qui tentent de voir clair dans les jeux fantasques et déroutants des
particules fondamentales, insaisissables protées du microcosme.
Il est de la physique moderne une troisième aporie digne d'être
mentionnée ici. Elle relève de la cosmologie, cette récente et
puissante extension de l'astronomie qui, on l'a rappelé, permet au
physicien de donner un âge à l'Univers.
Une des propriétés principales, reconnue depuis longtemps aux
lois de la mécanique newtonienne, est qu'elles sont valables en n'importe
quel lieu et à n'importe quel instant. A vrai dire, la possibilité de
refaire une expérience dans les mêmes conditions, en tout temps et en
tout lieu, afin d'en vérifier les résultats, constitue une des propositions
les plus généralement reçues de toute science moderne. La
cosmologie n'y devrait pas faire exception. Aussi prend-elle le soin
de poser au départ de ses recherches les trois principes —valables
«à grande échelle» seulement — de l'existence du mouvement
naturel local, de l'isotropie et de l'homogénéité de l'Univers.
L'importante réserve «à grande échelle seulement» qui limite
la validité de ces principes, en signale le caractère à la fois artificiel
et nécessaire. Artificiel parce que c'est à peine si ces principes sont
suggérés par l'expérience — et ils échappent, bien sûr, à toute vérification:
le temps où des cosmonautes s'arrêteront sur la nébuleuse
d'Andromède pour expérimenter n'est pas encore en vue... Nécessaire
parce que sans ces principes, le physicien serait incapable de
justifier toute extrapolation des lois qui seules lui permettent
d'ordonner l'Univers.
Toutefois, les difficultés liées à l'énoncé des principes de la
cosmologie sont encore fort acceptables comparées à celles qui
surgissent lorsque se pose le problème de répéter des observations
cosmologiques à des époques différentes. Dès le moment où la
physique donne de l'Univers, un modèle qui n'est pas stationnaire
mais qui, au contraire, lui assigne un âge bien défini, il faut s'attendre
à voir cet âge intervenir dans les équations d'évolution.
Qu'est-ce à dire, sinon qu'en cosmologie, une observation ne peut
jamais être répétée exactement dans les mêmes conditions: un paramètre,
l'âge de l'Univers, varie nécessairement d'une expérience
à l'autre. A cet égard, la cosmologie d'un univers dont l'âge
peut être calculé n'est pas une théorie scientifique au sens communément
reçu du terme. Et il y a plus grave encore: les lois mêmes
de la physique ne peuvent plus prétendre à l'invariance par rapport
au temps que réclamait pour elles Newton: elles aussi peuvent
dépendre de l'âge de l'Univers. Et il n'est pas possible à la cosmologie
de tourner la difficulté en raisonnant sur d'éventuelles disparités
dans les échelles de temps —celles des phénomènes physiques
étant par exemple si réduites par rapport à l'âge de l'Univers que
ce dernier pourrait être considéré comme stationnaire! Ce serait
en effet, face à l'expérience, adopter sans raison des positions
contraires touchant l'uniformité du temps et l'homogénéité de
l'espace et, du même coup, prêter le flanc à la critique justifiée
d'incohérence logique! On le voit: pas de cosmologie pour un
univers d'âge déterminé qui n'entraîne une mise en question radicale
de la physique par la physique!
Les trois apories qui viennent d'être mentionnées ne sont, bien
sûr, pas les seules difficultés de caractère fondamental rencontrées
ces dernières décennies par la physique moderne. Tout au plus
peut-on leur accorder une valeur exemplaire qui permet de se faire
une idée du genre de problèmes que soulève leur apparition.
C'est ainsi qu'une première question vient à l'esprit: ces apories
sont-elles des accidents, conséquences fortuites du rapide développement
de certaines branches de la physique, ou bien manifestent-elles,
au contraire, un trait caractéristique et constant de la réflexion
et de la démarche du physicien contemporain?
Avant de répondre, voici trois remarques destinées à préciser
la question. En premier lieu, l'existence d'une aporie apparaît liée,
d'une façon ou d'une autre, à la naissance d'une branche ou d'un
domaine important de la physique. Le plus souvent l'aporie est
même étroitement associée à l'énoncé d'un principe servant de
base à la nouvelle théorie, ce qui lui confère d'ailleurs un caractère
indiscutable de généralité sinon de profondeur.
En second lieu, même si, par la façon dont elles sont formulées,
ces apories peuvent apparaître parfois très abstraites, elles tiennent
toutes de très près à l'expérience, et même à ce que l'expérience
offre de plus élémentaire: référentiel et mesure des distances, couplage
du système à l'appareil d'observation, reprise des mêmes
mesures à des époques successives.
En troisième lieu enfin, si ces apories permettent quelque doute
sur la parfaite cohérence de telles théories physiques, il est patent
que les théories ainsi mises en question sont précisément parmi les
plus puissantes, parmi celles qui ont remporté les succès les plus
éclatants, aussi bien dans l'explication de phénomènes restés jusque-là
obscurs que dans la prédiction d'événements nouveaux,
plus tard confirmés par l'expérience. A cet égard, il faut le reconnaître,
la théorie de la relativité comme la mécanique quantique
sont exemplaires.
Ainsi, l'apparition d'apories n'est pas accident, mais bien plutôt
trait caractéristique des théories physiques contemporaines.
D'où cette nouvelle interrogation: pourquoi donc ces apories?
Pourquoi n'est-il pas possible d'éviter ces difficultés mettant en
question les théories ou les modèles physiques avant même que
ceux-ci aient atteint leurs objectifs ou même déployé leurs vertus?
C'est ici qu'apparaît en pleine lumière la gageure que se plaît
à tenir le physicien en bâtissant ses théories: rendre compte fidèlement
d'une nature tyrannique tout en sauvegardant les exigences
d'une raison non moins contraignante. Or, pour le physicien qui
jauge sa théorie, l'adéquation à l'expérience reste le critère souverain.
D'où la tentation toujours menaçante de composer avec la
rigueur logique, soit en usant de concepts insuffisamment dessinés,
soit en assouplissant à trop juste convenance les règles du raisonnement
scientifique. Le danger d'une telle manoeuvre, c'est de s'y
laisser prendre soi-même, et de juger que l'adéquation à l'expérience
constitue en soi une justification a posteriori des accommodements
consentis. Ce qui n'est — et ne sera —jamais: la plus
solide des théories étant constamment menacée par l'expérience.
Ainsi, tant que le physicien bâtira des théories, il est probable
que celles-ci laisseront apparaître des apories d'autant plus sérieuses
que les théories seront plus novatrices. Cela tient à la condition
humaine du physicien face à la Nature: voué à la décrire le plus
fidèlement possible mais condamné à voir une partie de ce qu'il
veut décrire constamment lui échapper, il bâtit des édifices provisoires
sur de précaires fondations.
On rapporte qu'au moment où, pour la première fois, Newton
calcula la force d'attraction exercée par notre globe sur la Lune,
ses adversaires tentèrent de le tourner en dérision: «Comment
pouvez-vous prétendre calculer l'action de la Terre sur la Lune qui
est si loin, alors que vous ne savez rien ou pratiquement rien de
l'intérieur de la Terre, ici tout près?» Cette critique était éminemment
raisonnable, il faut le reconnaître. N'empêche que la Nature
ne s'en soucia guère, qui donna raison à Newton: les calculs
de sir Isaac connurent la sanction des faits. Ce fut seulement bien
plus tard, lorsque les astronomes voulurent expliquer les fines irrégularités
du mouvement de notre satellite, qu'il s'avéra indispensable
d'en savoir un peu plus sur notre globe.
A n'en pas douter, cette possibilité de faire une bonne théorie
d'un système sans en bien connaître tous les éléments constitue
un trait propre à la physique. Et c'est précisément dans la
façon de reconnaître puis de cerner cet inconnu que s'affirme le
talent du théoricien. Ainsi, pour le physicien comme pour tout
homme de science d'ailleurs, le premier pas consiste à reconnaître
son ignorance. Efficacité et honnêteté intellectuelle vont ici de pair.
Alors pourquoi, en ce temps où la science est devenue comme
la religion du plus grand nombre, pourquoi l'homme de ce siècle
prête-t-il si peu d'attention à ce premier pas nécessaire et significatif
de la démarche scientifique, afin d'en tirer leçon pour soi-même?
Que l'homme moderne, au lieu de porter imprudemment savants
et techniciens d'aujourd'hui sur d'éphémères piédestaux, que
l'homme moderne se laisse pour un temps du moins éclairer de leur
méthode! Qu'il parte ainsi à la découverte de sa propre ignorance,
afin d'en faire cette «ignorance qui se connaît» si chère à Pascal!
Rien n'empêcherait plus alors l'homme de ce siècle, émerveillé certes
à la vision des dernières lueurs de l'explosion primitive vagabondant
dans l'univers, rien n'empêcherait plus cet homme d'y reconnaître
comme les lointains reflets de cet autre éclair qui naguère dévala
les cieux: celui du glaive des chérubins placés par Yahvé le soir de
la chute aux portes du jardin d'Eden, afin d'y garder le chemin
menant à l'arbre de vie.
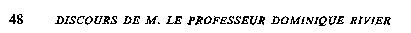
Saisira-t-il, cet homme de notre siècle, qu'en misant sur la Science
et sur ses seules vérités, — dussent-elles lui permettre d'arpenter
l'univers et d'ordonner la société —, saisira-t-il qu'il est bien vain
pour lui de s'essayer à forcer ainsi le chemin de la vie? Car,
aujourd'hui comme hier, demain comme aujourd'hui, la condition
pour y parvenir, c'est de suivre les pas de Celui qui, un autre
soir, celui du dernier repas, révéla à Thomas le chercheur: «Je
suis le Chemin, la Vérité et la Vie.»