DIES ACADEMICUS 1974
PRIX ET CONCOURS
LIBRAIRIE PAYOT LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ LAUSANNE 1975DISCOURS DE M.
RECTEUR DE L'UNIVERSITÉ
Monsieur le Conseiller d'Etat,Vous avez bien voulu tout à l'heure transmettre à l'Université les salutations et les voeux du Gouvernement. L'Université vous en sait gré. Elle vous prie de faire part au Conseil d'Etat de ses remerciements auxquels elle ajoute l'expression de ses sentiments d'allégeance.
C'est avec intérêt et — si vous le permettez, Monsieur le Conseiller d'Etat — avec satisfaction que le Rectorat vient de prendre connaissance de vos déclarations. Car celles-ci vont affermir une conviction récente mais d'importance: bien loin de remettre en question la politique d'autonomie innovée puis pratiquée par votre prédécesseur à l'égard de l'Université, vous proclamez la vouloir poursuivre. Et nous savons que vous vous y attacherez avec la fermeté et la constance qui vous ont signalé à vos concitoyens — qu'il s'agisse des interventions du parlementaire que vous fûtes ou des actes de l'homme d'Etat que vous êtes.
C'est ainsi que cette année encore le Conseil d'Etat a bien voulu faire confiance au Sénat et au Rectorat dans la préparation, l'ajustement et l'exploitation du budget de l'Université. Et c'est dans le même esprit de collaboration et de confiance que celle-ci s'apprête à mettre sur pied, à l'intention de l'Etat, un nouveau plan de développement de quatre ans, plan de développement qui pour la première fois portera sur l'ensemble de toutes les facultés et écoles.
Cette continuité dans la politique suivie par le Conseil d'Etat dans ses relations avec l'Université est de bonne augure en un moment où, au plan cantonal comme au plan fédéral, les parlements viennent de voter ou vont se prononcer sur des textes constitutionnels et légaux concernant l'enseignement supérieur et la
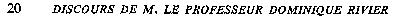
recherche. Car il est évident que ces textes n'engageront pas seulement
l'avenir des hautes écoles de Suisse et de l'Université de
Lausanne, mais aussi celui de tout le système de notre enseignement
et, par là, l'avenir du pays dans son ensemble.
Il importe aujourd'hui de le dire haut et clair. Plus que jamais, l'Université doit pouvoir faire usage de son autonomie pour franchir la passe semée d'embûches vers laquelle l'ont poussée les vents tantôt favorables, tantôt contraires de la croissance économique, de la promotion sociale et de la démocratisation des études.
Mise en question de multiples côtés, menacée dans son existence de l'intérieur autant sinon plus que de l'extérieur, l'institution universitaire ne saurait en définitive rechercher ailleurs qu'en son sein la volonté et les forces qui devraient lui permettre de persévérer dans l'accomplissement de ses tâches au service de la société. Certes, il importe qu'elle prenne conscience des changements profonds par lesquels passe notre monde. Mais cela ne signifie pas qu'elle doit suivre les modes ou crier avec les loups. Au contraire, c'est en pleine indépendance qu'il lui faut discerner la voie difficile de la fidélité à sa vocation, celle qui dès les origines — il y a de cela plus de huit cents ans, c'était à Bologne —fit de l'Université un lieu où les lois de l'esprit devaient régner sans partage. Et c'est aux pouvoirs, c'est notamment à l'Etat, qu'il appartient, aujourd'hui comme il y a huit siècles, de garantir cette liberté sans laquelle il n'y a pas d'Université. Etant entendu que, de son côté, l'Université accepte le double corollaire de cette liberté: premièrement, ne pas transiger sur les exigences de l'enseignement supérieur et de la recherche; secondement ne pas sortir de son espace pour jouer les politiques ou les prophètes.
C'est là précisément le thème des réflexions qui vont suivre. Après être revenu sur la vocation traditionnelle et spécifique de
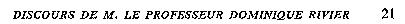
l'Université, pleinement recevable à ce jour encore, j'évoquerai les
dangers que fait courir à l'Université la crise profonde qui ébranle
le monde contemporain. Ce sera l'occasion de signaler qu'une des
activités essentielles de l'Université est a ce jour plus particulièrement
menacée: la recherche. Une brève analyse de quelques-unes
des formes prises par cette menace conduira à un certain nombre
de suggestions sur la façon de combattre ce péril, probablement un
des plus sérieux qui jamais aient atteint l'Université.
Dès les origines, la vocation de l'Université s'est imposée avec netteté: édifier et transmettre la connaissance, plus précisément rechercher la vérité et la faire connaître à ceux qui sont prêts à consentir l'effort nécessaire pour cela. Cette vocation apparaît aussi bien dans le nom même de la corporation «Universitas magistrorum et scholarium» que dans la première des règles de conduite que l'institution naissante s'est spontanément donnée: «reconnaître la libre confrontation des idées comme la meilleure voie pour atteindre à la vérité».
Il est à la fois remarquable et significatif que dès les origines a été affirmée la dualité fondamentale du processus de la connaissance: s'il y a des maîtres et des élèves, c'est qu'il faut à la fois développer et transmettre la connaissance: recherche et enseignement sont indissolublement liés et c'est là un aspect essentiel de la vérité telle que la construit l'esprit: loin d'être immuable et figée, elle vit, elle croît; conquête de l'esprit, elle gagne en retour les intelligences.
L'histoire de l'Université illustre d'ailleurs à merveille la profondeur de ce lien entre la recherche et l'enseignement. 1
Il est arrivé parfois que des instituts ont abandonné la recherche pour se consacrer uniquement à l'enseignement. Que constate-t-on alors: au bout d'un temps plus ou moins long — mais immanquablement —l'enseignement, sinon le maître, s'étiole et tend à se scléroser; il perd son rôle de formateur, son rayonnement et son pouvoir de culture. D'ailleurs, nombreux sont les élèves qui, après coup, ont découvert tout ce qu'un enseignement particulièrement
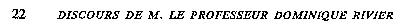
rayonnant devait à la réflexion et aux travaux du chercheur qui se
cachait derrière le maître!
Inversement, chaque fois que dans certaines facultés on s'est désintéressé de l'enseignement pour donner tout l'effort à la recherche, la situation n'a pas tardé à se dégrader, en dépit de succès initiaux: les laboratoires ou les séminaires ont eu tendance à se transformer en chapelles, et la science s'est progressivement muée en religion ou magie. Pour être recevable à l'Université, la connaissance doit passer par l'épreuve de la transmission. N'est-il pas fréquent que des maîtres de la pensée ou de la Science reconnaissent ce que leurs théories ou leurs découvertes doivent à leur activité d'enseignant et même à leurs élèves? On sait aussi avec quelle impatience parfois le maître attend le séminaire où il peut soumettre le résultat de ses recherches à l'appréciation des disciples, jugement dont dépend la décision difficile: publier ou remettre une fois encore l'ouvrage sur le métier!
Il existe donc entre la recherche et l'enseignement supérieur ce lien remarquable que l'une de ces activités ne saurait être séparée de l'autre. L'enseignement ne peut ignorer la recherche parce que celle-ci, remettant perpétuellement en cause le contenu, les méthodes et quelquefois même le sens de l'enseignement, lui donne élan et vie. Semblablement, la recherche ne saurait se passer de l'enseignement car celui-ci, tenu d'éprouver systématiquement la solidité des voies et la durabilité des acquis de la recherche, lui apporte une sorte de consécration en même temps qu'il en consolide les bases et renouvelle les objectifs. «Ce qui caractérise l'enseignement supérieur», disait à peu près Humboldt, «c'est qu'il tient son objet, la connaissance, comme fondamentalement inaccessible; ce qui ne doit pas empêcher de le rechercher inlassablement, précisément comme s'il pouvait être atteint.»
Ainsi c'est bien l'unité foncière de cette double mission: édifier et transmettre la connaissance qui, aujourd'hui encore, donne la meilleure définition de l'Université. Et c'est seulement dans la mesure où celle-ci s'est acquittée de ces deux premières tâches qu'elle peut remplir les autres à satisfaction. En effet, comment
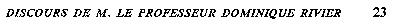
donner la formation de base nécessaire aux professions qui
demandent une instruction supérieure, comment promouvoir et
faire rayonner la culture sans disposer d'un enseignement nourri
par la recherche?
Par ailleurs, ce qui n'est pas moins remarquable et significatif, c'est la façon dont, dès les origines aussi, l'Université a su poser la condition nécessaire à l'exercice de ses activités fondamentales, à savoir: la reconnaissance de la libre confrontation des idées comme la meilleure voie pour atteindre à la vérité. C'est pour obtenir cette reconnaissance que la corporation des maîtres et des élèves a demandé la protection des autorités politiques et ecclésiastiques: l'Université ne peut remplir sa mission si elle n'est pas un lieu où l'esprit peut faire prévaloir ses lois.
Cette constatation est illustrée de façon saisissante par l'histoire: l'Université médiévale connaît la décadence dès le moment où elle prend parti dans les conflits religieux ou politiques, qu'il s'agisse du grand Schisme d'Occident ou du procès de Jeanne d'Arc. Et le phénomène se répète chaque fois que l'Université commet la faute de s'engager au plan politique: que l'on songe seulement à l'éclipse de l'Université française aux XVIIIe et XIXe siècles, puis à l'effacement des universités allemandes au XXe!
D'une façon complémentaire, chaque fois que l'Université ressuscite ou naît à nouveau —que ce soit à Oxford, à Leyden ou à Göttingen, à Paris, à Halle ou à Berlin —, elle doit commencer par réaffirmer le principe de la liberté de discussion, comme condition indispensable à son existence, puis à l'exercice de ses activités fondamentales, l'enseignement et la recherche.
On ne saurait, à notre époque, trop méditer sur cette vérité historique: la recherche de la vérité ne connaît ni le compromis politique ni le subjectivisme religieux, quand bien même la Théologie et la Science politique jouissent d'un droit de cité bien établi dans l'Université.
Si l'Université est l'institution où, par excellence, la recherche est intimement liée à l'enseignement, c'est que l'activité de recherche doit y jouer un rôle de premier ordre. Il importe d'examiner de plus près quel est ce rôle et pourquoi il est irremplaçable.

Une remarque s'impose d'emblée: l'activité de recherche recouvre des situations très différentes d'une faculté à l'autre. En ce siècle que la Science et la technique ont fait leur, l'image du chercheur la plus communément répandue est probablement celle que donnent les films de science-fiction: le savant en blouse blanche dans son laboratoire, perdu dans des théories d'éprouvettes fumantes ou retranché derrière des ordinateurs à clignotants, tantôt plongé dans une méditation de profondeur einsteinienne, tantôt distribuant à mi-voix des ordres incompréhensibles à un personnel muet, soumis et admiratif, et comme lui en blouse blanche.
Si cette caricature s'appuie sur un fond de vérité lorsqu'il s'agit des sciences expérimentales ou de la technique, elle devient impertinence et même mensonge pour les sciences humaines: que l'on songe au théologien dans sa cellule, au juriste dans son cabinet ou à l'homme de lettres dans sa bibliothèque, au sociologue enquêtant dans la rue ou au psychologue chargeant ses batteries de tests! Face à cette variété de situations, rien de surprenant à ce qu'il ne soit pas facile de cerner l'activité de recherche dans les sciences humaines, dont on sait que la plupart sont en pleine mutation. Et pourtant, le vocabulaire ne serait-il pas un révélateur inattendu? L'emprunt du terme «Science» ne trahit-il pas ici ou là une propension à simuler sinon à suivre l'exemple de certaines disciplines des sciences exactes?
En raison de causes diverses, les unes épistémologiques, d'autres pédagogiques, d'autres enfin simplement pratiques, les sciences humaines paraissent en effet avoir subi la fascination des sciences exactes. Peut-être pour se guérir d'un complexe d'infériorité manifestement sans fondement et peut-être aussi parce qu'elles espèrent ainsi obtenir des moyens plus substantiels, elles ont de nos jours tendance à se conformer aux modes et aux schémas proposés par la chimie, la physique ou la biologie. Cela n'empêche pas que même à l'intérieur des sciences humaines, il existe des différences considérables d'une discipline à l'autre: celles qui se regroupent autour des humanités traditionnelles — et qui s'intéressent davantage à la connaissance du passé —paraissent beaucoup
moins pressées de suivre ces modèles que les branches tournées vers l'étude du contemporain, comme la plupart des sciences sociales.
Au surplus, cette propension à s'inspirer de l'exemple des sciences exactes apparaît aussi dans la tendance, plus ou moins marquée suivant les disciplines, de substituer le travail en équipe à l'individualisme qui a si longtemps caractérisé et qui caractérise encore la recherche dans les sciences humaines.
II est en revanche un point sur lequel, dans bon nombre d'instituts, les sciences humaines se distinguent de la médecine et des sciences exactes: c'est le moment auquel l'étudiant est admis à participer à la recherche.
Dans les instituts de la Faculté des Sciences, par exemple, cette initiation commence le plus souvent au tout dernier stade des études, quelquefois avec la préparation du diplôme et le plus souvent avec celle de la thèse. C'est une affaire délicate et soumise au contrôle attentif des maîtres et de leurs collaborateurs.
Dans certaines facultés et écoles des sciences humaines, au contraire, tout semble se passer comme si l'étudiant pouvait être appelé dès ses premières années d'études à des activités de recherches, celles-ci ne paraissant pas exiger l'acquis de connaissances préalables dûment éprouvées. L'explication probable de ce paradoxe tient peut-être en ceci qu'on entend par recherche quelque chose de fort différent d'une faculté à l'autre.
Du côté des sciences exactes il est admis qu'un projet de recherche doit avoir pour but de faire avancer non pas seulement les connaissances de ceux qui participent effectivement au projet, mais aussi de l'ensemble de tous les chercheurs engagés dans la discipline intéressée où qu'ils soient. Autrement dit une recherche vise à mettre en évidence un fait ou une théorie, contribution nouvelle au sens absolu et général du terme.
Il semblerait que les exigences soient d'une nature différente du côté de certaines sciences humaines où, précisément, reste prépondérant l'aspect particulier de la formation du futur chercheur, cela d'autant plus que dans ces sciences les lois de caractère universel sont plutôt rares. L'objet de la recherche paraît être de mettre en
évidence des faits plutôt que d'en induire nécessairement des règles strictes et générales.
En tout état de cause, on ne saurait trop souligner combien sont essentielles ces différences dans la conception de la recherche d'une faculté à l'autre. Sous réserve bien sûr que le niveau de la réflexion et les exigences intellectuelles restent comparables, elles traduisent la grande variété dans les démarches du chercheur, tenu d'adapter ses méthodes à l'objet de ses investigations. Toute tentative d'uniformisation dans ce domaine ne constituerait qu'une menace supplémentaire pour la recherche universitaire.
Examinons maintenant le rôle spécifique de la recherche dans l'Université afin de mettre en évidence le caractère irremplaçable de cette activité, en évitant toutefois de revenir à l'action particulière —déjà reconnue tout à l'heure comme indispensable — que la recherche exerce pour soutenir, nourrir et renouveler l'enseignement supérieur.
Ce rôle de la recherche paraît déterminant aux trois niveaux de l'individu —qu'il enseigne ou non —de l'Université en tant qu'institution, et de la société en tant que milieu supportant l'Université.
L'activité de recherche est irremplaçable pour le professeur et ses collaborateurs parce qu'elle seule leur donne la certitude de pouvoir maintenir en éveil suffisant l'imagination et leur permet d'éprouver la vivacité de l'intelligence. Il n'en va pas tout à fait de même pour l'enseignement qui a su parfois s'accommoder de certains assoupissements, conscients ou non. C'est le lieu de souligner que l'esprit de recherche est avant tout une manière, une attitude dans la reflexion ou l'action — quelles qu'elles soient — et que sa présence n'est pas automatiquement garantie par la participation effective à un projet de recherche. Tel professeur qui remet sans cesse sur le métier des chapitres de son cours parce qu'il ne peut s'en déclarer satisfait, fait déjà oeuvre de recherche, à l'inverse de tel autre qui, bien que collaborateur attitré d'une équipe consacrée de chercheurs, se laisserait aller à la routine!
L'activité de recherche est irremplaçable dans l'Université en tant qu'institution, parce qu'elle constitue, à ce niveau, la meilleure
sinon la seule force de renouvellement du cadre et des structures de l'enseignement. L'apparition de nouvelles disciplines comme la création de nouveaux instituts sont, on le sait, une des conséquences les plus remarquables des recherches accomplies dans les universités. Pour prendre deux exemples à Lausanne, que l'on songe aux enseignements de linguistique d'introduction récente, ou encore à l'institut de zoologie et d'écologie animale aménagé il y a quelques années seulement.
Enfin l'activité de recherche dans les facultés est irremplaçable. pour la société dans laquelle vit l'Université. C'est en effet grâce à cette activité que l'Université peut devenir, pour la société, ce puissant facteur de développement et de dépassement qu'il a été à plusieurs reprises dans l'histoire. D'une part à travers les hommes — magistrats, pasteurs, avocats, éducateurs, savants — dont l'Université s'applique sans cesse à renouveler la formation, et d'autre part à travers les oeuvres de ses maîtres, de leurs collaborateurs et de leurs élèves — travaux scientifiques ou littéraires, découvertes, réalisations industrielles ou contributions de toute autre nature. Cette action parfois considérable de l'Université sur la société est attestée par le rôle — tantôt prépondérant tantôt négligeable suivant la vitalité des hautes écoles — qu'ont eu les universités dans le développement de la civilisation occidentale au cours de ces derniers siècles. Au point qu'on peut se demander si, en définitive, le destin unique de cette civilisation n'est pas le résultat de la présence, sur le continent, du grand nombre de ces foyers de culture que furent les universités.
L'histoire ancienne et récente démontre que les multiples crises par lesquelles ont passé les Etats et la société ont presque toujours eu leur répercussion dans les universités. Notre époque ne fait guère exception: on sait en. effet que les troubles qui marquèrent la vie des universités dès les années 60 ont eu leur origine dans les crises qui ont agité les sociétés chinoises, américaines et européennes.
Avec un peu de recul, il est aujourd'hui possible de distinguer au moins cinq causes de crise ou de trouble dans les universités
contemporaines 1: la surpopulation des facultés, la dispersion des forces (conséquence de la multiplication des tâches), les contraintes financières, l'inertie croissante des infrastructures universitaires et enfin les pressions socio-politiques. La plupart de ces phénomènes sont connus; il suffit donc de les rappeler brièvement pour montrer comment chacun d'eux, à sa manière, paraît menacer plus particulièrement la recherche universitaire.
Commençons par la surpopulation dans les facultés. Ce phénomène, qui a vu le doublement en dix ans du nombre des étudiants, a récemment été évoqué ici même. C'est la conséquence prévisible d'une part de l'accroissement démographique et d'autre part de la réforme des études, particulièrement de l'élargissement de l'enseignement secondaire à une partie toujours plus nombreuses de la population. Si des mesures ne sont pas prises au niveau de l'enseignement tertiaire, cette surpopulation des universités pourrait bien durer de nombreuses années encore, avec tous les risques qu'elle implique. L'Université est en effet tenue d'enseigner tous ses étudiants, même s'ils sont en surnombre. Il s'agit d'une obligation légale qui la contraint alors de faire l'effort principal sur l'enseignement. Or cela n'est possible qu'au détriment de la recherche, qui serait sacrifiée la première en cas de pénurie de personnel enseignant, de locaux ou de crédits. La surpopulation des universités peut donc toucher directement le niveau et la qualité de la recherche, parce qu'elle prive cette dernière d'une partie des moyens qui lui sont indispensables.
Une deuxième cause de trouble et de difficultés dans les Universités, c'est la dispersion des forces consécutive à l'augmentation des tâches assignées à l'Université: il ne s'agit pas seulement de la multiplication du nombre des enseignements, suite au foisonnement des spécialités et des nouvelles disciplines, mais encore des types nouveaux de formation que l'on veut confier à l'Université: formation continue, formation récurrente, éducation des adultes, initiation à la culture. Là encore, écrasée sous le nombre croissant de ses responsabilités d'enseignement, l'Université ne pourra faire
autrement que diminuer les activités de recherche afin de dégager le personnel et les locaux en admettant — ce qui n'est pas certain — que les gouvernements fournissent les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses nouvelles tâches. Ainsi, la deuxième menace qui pèse sur l'Université, celle de la dispersion des forces, affecte elle aussi plus particulièrement les activités de recherche.
Un troisième facteur de dégradation du climat dans les Universités a moins souvent retenu l'attention: il s'agit de l'alourdissement général des infrastructures nécessaires à la recherche et à l'enseignement supérieur. Ces dix dernières années, l'on a assisté à une augmentation spectaculaire des effectifs du personnel scientifique et technique, du nombre et de la masse des équipements d'enseignement et de recherche ainsi que des locaux spécialisés nécessaires à ces activités. Tout cela augmente les coûts d'exploitation (les budgets des hautes écoles ont en moyenne quadruplé au cours de ces dix dernières années) et confère un poids considérable à la machine universitaire. Cette inertie tend non seulement à devenir une entrave au développement mais, ce qui est plus grave, compromet les possibilités d'adaptation aux situations nouvelles, internes ou extérieures. Et dans la mesure même où la recherche est l'élément moteur, le facteur de renouvellement dans la vie des facultés, il est évident que l'inertie croissante de la machine universitaire menace beaucoup plus les activités de recherche que toutes les autres. C'est ainsi qu'un directeur d'institut consentirait difficilement à la réorientation de ses recherches qui mettrait au rancart un équipement fraîchement acquis pour plusieurs millions, et qu'il peut être tenté de préférer à ce changement la poursuite sans grands frais — mais sans espoir — de recherches de routine dans un domaine qu'il il sait dépassé! Point d'alternative de cette ampleur pour les réformes de l'enseignement!
Ainsi l'accroissement inéluctable des infrastructures nécessaire à l'activité des facultés est un facteur qui, lui aussi, joue en premier lieu contre le développement de la recherche.
Une quatrième source de tension et de difficultés pour les universités contemporaines paraît étroitement liée aux trois premières: c'est l'insuffisance croissante des moyens financiers comparés aux
besoins de l'enseignement et de la recherche. Ce phénomène est bien connu. Il faut se rappeler qu'il y a une dizaine d'années rien n'avait été prévu pour permettre aux universités de faire face au doublement du nombre des étudiants, à l'augmentation des tâches, comme à l'accroissement prodigieux des infrastructures. C'est pourquoi elles ont soudain représenté d'énormes charges financières pour ceux qui devaient les entretenir, alors qu'aucune politique n'avait été élaborée pour dégager les crédits nécessaires. D'un bout à l'autre des facultés et écoles et du haut en bas de la quasi-totalité des universités d'Europe, l'on se trouve aujourd'hui à court de personnel, de locaux et d'argent. Là encore, bien évidemment, ce n'est pas l'enseignement' que l'on va sacrifier, car il est des obligations à court terme auxquelles il n'est pas possible de se dérober. En revanche diminuer les activités de recherche, cela ne porte pas à conséquence dans l'immédiat, d'autant plus qu'elle coûte en général plus cher que l'enseignement. On voit ainsi comment l'insuffisance des moyens financiers provoque inévitablement une diminution des efforts pour la recherche, ici encore la plus menacée.
Il n'est pas possible de taire une dernière cause de difficultés dans les années présentes: c'est l'existence de pressions socio-politiques exercées par la société sur les Universités. Ces pressions peuvent être de nature fort diverses et varier beaucoup d'un pays à l'autre. Il suffit ici de se limiter à deux d'entre elles qui paraissent les plus menaçantes.
Il y a d'abord les pressions dues aux changements qui ont affecté les priorités généralement admises par l'opinion en matière de développement social. Jusqu'au début des années 60, les premiers objectifs à atteindre n'étaient pas discutés: c'était l'augmentation du niveau de vie et le plein emploi. Mais depuis lors ces priorités ont été mises en question: dans des couches de population de plus en plus larges, elles ont cédé la place à d'autres impératifs comme l'établissement d'une société plus juste dans laquelle l'amour devrait remplacer la guerre, ou comme la nécessité de faire disparaître les inégalités criantes qui séparent les peuples favorisés des autres.
Comme l'on sait ces nouvelles aspirations ont rapidement gagné la jeune génération et particulièrement les étudiants, peut-être plus sensibles aux injustices du fait de leur situation privilégiée. Il n'est donc pas étonnant que, mus par ces sentiments, ils aient eu quelques réticences parfois à travailler dans des universités qui leur apparaissaient non sans raison comme isolées du monde, politiquement et socialement neutres en un temps où, pour beaucoup, être neutre c'est prendre parti pour l'oppresseur contre l'opprimé.
De là à identifier de façon primaire et hâtive l'Université à une société que l'on considère comme égoïste, il n'y a qu'un pas que beaucoup ont franchi —et pas seulement des étudiants. Sans avoir discerné le véritable rôle de l'Université, ils se sont mis à la critiquer, parfois injustement. C'est la montée de la contestation, dont on sait qu'elle a depuis 1968 entraîné beaucoup de changements dans nombre d'universités. On a vu ainsi la gestion des facultés, parfois même des universités, confiée à des conseils où des étudiants et des assistants siégeaient à côté des professeurs. Si la mise en place souvent hâtive de cette participation a momentanément détendu l'atmosphère, elle a. presque toujours perturbé le fonctionnement des universités. Et là encore, c'est l'activité de recherche qui, la première, a pâti du changement de régime. Au point que l'on a vu de nombreux professeurs fuir des facultés désorganisées afin de poursuivre ailleurs leurs travaux de recherche.
Il y a un second groupe de phénomènes, lui aussi de nature socio-politique, qui fait peser une certaine menace sur les universités, à plus long terme il est vrai. Il s'agit de l'avènement d'un nouveau scepticisme, fondamental, et dirigé contre la pensée objective et contre la raison. Selon les adeptes de cette attitude intellectuelle, l'acquisition de connaissances rationnelles, le développement de la science et de la technique ne constituent plus la meilleure voie pour atteindre le bien général. C'est ainsi qu'il faudrait délaisser l'étude objective du monde pour se tourner vers les satisfactions plus immédiates des sens, des sensations et des sentiments. Car ces satisfactions n'offriraient pas seulement les seuls biens authentiques de ce monde, elles constitueraient aussi la meilleure voie pour accéder à la vérité.
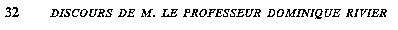
Déjà influent aux Etats-Unis, ce mouvement attire surtout les jeunes gens, dès la sortie des collèges; il tend à les détourner de poursuivre leurs études, quelles qu'elles soient. S'il devait prendre de l'ampleur et gagner l'Europe, il pourrait bien aboutir à une révolution sans précédent dans l'histoire des universités, car la montée d'un tel scepticisme généralisé mettrait en question les concepts mêmes qui servent de fondement à la mission de l'Université traditionnelle. Il va sans dire que cette critique radicale s'attaquerait d'abord à la recherche universitaire, considérée à juste titre comme l'activité type et l'expression par excellence du mal qu'il faudrait combattre.
Pour résumer, force est de constater que les menaces qui pèsent sur l'Université visent toutes plus particulièrement la recherche. Et dans la mesure même où l'activité de recherche constitue l'élément moteur et réformateur dans l'Université, la situation créée par la convergence de toutes ces menaces ne laisse pas d'être sérieuse. Il appartient à ceux qui ont la responsabilité du développement des hautes écoles d'exercer ici la plus grande vigilance.
Face aux temps difficiles qui s'annoncent pour elles, les universités sont certes en droit d'attendre de la compréhension et même de l'aide de la part de ceux qui les entretiennent. Mais quels que soient les intérêts des Etats ou de la société —et ils sont grands — à maintenir des hautes écoles où les activités de recherche soient vivantes et fructueuses, ils ne sauraient se substituer aux universités pour faire les réformes qui s'imposent. C'est aux universités qu'il incombe de prendre leurs responsabilités: premièrement parce que ce sont elles qui sont mises en question, secondement parce qu'elles restent à ce jour les mieux placées pour trouver les voies qui permettront de surmonter les difficultés à venir. Il ne saurait être question de décrire ici ces voies. Je me propose plutôt, pour terminer, de faire quelques suggestions préliminaires.
1. Pour lutter contre les effets néfastes de la surpopulation dans les facultés, les universités ne peuvent se contenter de fermer leurs portes aux incapables ou d'éliminer les insuffisants et les malchanceux. Tout en maintenant leurs exigences de qualité dans
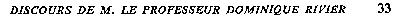
l'enseignement et la recherche, elles devraient collaborer à la
création — à leurs côtés — d'établissements auxiliaires d'enseignement
tertiaire. A ceux qui ne veulent ni ne peuvent entrer à l'Université,
ces établissements devraient donner la possibilité d'acquérir
dans l'excellence la formation nécessaire à l'exercice d'une activité
utile à la communauté. Aux mal-lotis et à ceux qui ont été mal
orientés, ils devraient offrir une seconde chance d'entrer à
l'Université.
2. La mise en service de ces établissements d'enseignement tertiaire devrait permettre aussi de décharger les universités des tâches nouvelles qu'on voudrait leur confier: éducation des adultes et formation continue notamment. Ainsi libérées, les universités pourraient continuer d'assumer pleinement leur mission dans le domaine de la recherche qui resterait de leur responsabilité spécifique. Cependant la nécessité d'une répartition judicieuse des tâches d'enseignement entre les établissements du niveau tertiaire obligerait les universités à collaborer étroitement avec ces derniers. Ce qui serait dans leur intérêt.
3. Pour lutter contre les effets conjugués de la dispersion des forces, de l'alourdissement des infrastructures et des contraintes financières, deux voies complémentaires s'offrent aux universités, celles de la coordination et de la réforme des enseignements.
4. La première voie, celle dans laquelle certaines universités se sont déjà engagées, est celle de la coordination. En dépit de déclarations pessimistes, des succès notoires ont déjà été enregistrés, et particulièrement en Suisse romande où depuis dix ans sont organisés des cours de troisième cycle communs à plusieurs hautes écoles qui connaissent beaucoup de succès. Parallèlement s'amorcent au niveau du second cycle des répartitions d'enseignement qui permettent déjà de substantielles économies. Il n'en reste pas moins que des progrès considérables restent à faire pour qu'une réelle concertation entre les universités existe au plan de la nation. Consciente de cette nécessité, la Conférence des recteurs suisses
a pris l'initiative de créer à cet effet une commission de planification universitaire, organe qui offre ses bons offices en vue de favoriser cette concertation.
Et ce qui est vrai de l'enseignement l'est aussi, mutatis mutandis, de la recherche. De même qu'il n'est plus possible d'enseigner tout partout, il n'est plus possible non plus de développer n'importe quelle recherche dans n'importe quelle université. Il semble cependant que deux conditions devraient être satisfaites avant que l'on procède à des ajustements dans la répartition des projets ou des thèmes. La première est que l'on respecte le rôle déterminant joué par la personne du chercheur, dont la liberté d'action et de réflexion doit être garantie. La seconde est que l'on associe étroitement les universités et particulièrement leurs facultés à tout ajustement dans la répartition des thèmes de recherches. A cet égard, la lecture du récent Rapport sur la recherche publié par le Conseil suisse de la Science laisse perplexe...
5. Il est évident que toute coordination universitaire a ses limites: il ne sert à rien d'épargner sur le salaire des professeurs s'il faut ensuite dépenser des sommes équivalentes pour transporter et nourrir des étudiants. Supprimer des enseignements dans une université pour simultanément les dédoubler dans une autre serait de la mauvaise gestion. C'est pourquoi, tôt ou tard, les universités devront s'engager sur la seconde voie, plus ardue il est vrai: celle de la réorganisation et de la refonte de leurs enseignements. En ce temps où les disciplines scientifiques et littéraires se multiplient sans fin, est-ce bien à l'Université de créer indéfiniment de nouveaux enseignements spécialisés, au fur et à mesure des besoins manifestés par les sciences, l'industrie, l'économie ou les administrations? Pourquoi d'autres partenaires, comme les associations privées émanant du monde de l'industrie ou de l'économie, ne participeraient-elles pas à la mise sur pied des enseignements de caractère professionnel? Cela permettrait à l'Université de concentrer ses efforts d'une part sur les enseignements de base et d'autre part sur les cours de troisième cycle à caractère fondamental pour la
recherche. Certes, l'entreprise est de taille et pleine d'embûches. En définitive elle ne saurait être confiée qu'aux facultés et écoles qui portent la responsabilité de la recherche et de l'enseignement. Mais il appartient aux rectorats de les inciter à s'y consacrer, en collaborant les unes avec les autres, notamment en vue de mettre sur pied des enseignements interdisciplinaires. Et il faut souhaiter que l'on arrive à chef avant qu'il soit trop tard. Car c'est vraisemblablement sur leur aptitude à conduire cette réforme des études que les universités vont être jugées, et il y va de leur autonomie.
6. Beaucoup plus difficile pour les universités paraît être de lutter contre ce que l'on a appelé tout à l'heure les pressions de nature socio-politiques, qu'il s'agisse des effets provoqués par les changements intervenus dans les priorités sociales, ou des contrecoups d'une éventuelle remise en question de la démarche rationnelle et de la connaissance objective comme méthode pour accéder à la vérité. Il s'agit là de phénomènes relativement récents dont il faut être conscient, mais auxquels il convient de prêter l'attention qu'ils méritent, ni plus ni moins. Une question paraît toutefois se poser: en tant qu'institution où, par excellence, se trouve garantie la liberté de chercher et d'enseigner, l'Université ne devrait-elle pas collaborer peut-être plus visiblement à la recherche des solutions à donner aux grands problèmes qui angoissent les hommes de notre temps: l'alternative du surnombre ou du vieillissement pour la population, le dilemme de la pollution, la répartition des matières premières, la meilleure utilisation d'une énergie sévèrement comptée...
Il est bien évident que, par leur dimension, ces problèmes dépassent largement chacun d'entre nous. Mais ne serait-ce pas un progrès de savoir que les facultés, leurs professeurs et leurs étudiants s'en occupent? N'y aurait-il pas là comme une forme moderne de cette responsabilité proprement éthique que Humboldt désirait voir confier à l'Université et à ses maîtres?
Mesdames, Messieurs,Solidaires des sociétés et des Etats qui les entretiennent, les universités vont au-devant de jours difficiles. Des changements les attendent qui les obligeront à faire des choix, dont certains dans la gêne et la peine.
Il faut souhaiter que, dans l'intérêt de tous, ces choix — et notamment ceux qui concernent la recherche — soient préparés par les universités elles-mêmes. De concert les unes avec les autres, et en pleine conscience de leurs responsabilités certes, mais en toute liberté. Il faut souhaiter aussi que les universités fassent le meilleur usage de cette liberté, non pas pour se sauver elles-mêmes, mais dans le but de servir la société et, en définitive, d'aider les hommes de ce temps à vivre mieux et à surmonter leurs angoisses.
Alors seulement les universités auront montré qu'elles sont dignes de l'autonomie qu'elles demandent. Alors seulement pourront-elles s'acquitter pleinement de leur mission.






