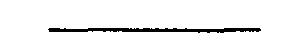DISCOURS DE M. LE Dr AIME CHAVAN
Professeur de théologie, recteur sortant de charge.
MONSIEUR LE CHEF DU DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, MESSIEURS LES PROFESSEURS, MESSIEURS LES ÉTUDIANTS, MESDAMES ET MESSIEURS,Dans le balancement d'un rythme obligatoire se succèdent, parfois coïncident, l'arrivée et le départ, le commencement et la fin, la naissance et la mort: c'est la loi même de la vie. Quand les organes se remplacent, l'organisme ne meurt point. Tant que le coureur qui s'arrête et qui va lâcher le flambeau trouve encore une main vigoureuse pour le saisir, la course continue... C'est à l'une de ces transitions que l'Université vous convie aujourd'hui. Elle aura, comme tous les phénomènes de cet ordre; sa mélancolie et son allégresse, d'où se dégageront peut-être les légères émotions, fines et délicates, du coeur et de l'esprit, que vous venez chercher dans ces augustes cérémonies. Ce passage se fait en général suivant un rite consacré, auquel nous resterons partiellement fidèles.
De ce rite traditionnel, certains éléments s'imposent. Je n'aurai garde d'y manquer. Et tout d'abord les remerciements d'usage, devenus habituels précisément parce qu'ils ont toujours répondu à une réalité. L'éternelle vérité peut seule être banale...
Je garde au Département de l'Instruction publique, en particulier à Messieurs les conseillers d'Etat Chuard et Dubuis, qui l'ont dirigé successivement pendant ces deux années, un souvenir reconnaissant pour la sollicitude dont ils ont entouré notre établissement d'instruction supérieure, et pour la cordialité des rapports que nous avons entretenus. Je rends le même témoignage à Messieurs les membres de la Commission universitaire, à M. le chancelier, et d'une manière générale à tous mes collègues des diverses Facultés, qui n'ont cessé de m'encourager et de me soutenir dans l'accomplissement d'une tâche toujours difficile, mais tout particulièrement délicate dans les circonstances exceptionnelles que les événements nous ont créées. Je vous parlerai dans le même sens, Messieurs les étudiants, Il y a deux ans, je faisais appel à votre sentiment de l'honneur. Ce ne fut pas en vain, et j'en étais sûr d'avance. Je vous sais gré de m'avoir dispensé de l'obligation désagréable de sévir. De nos rapports, je garde les impressions les plus aimables. Et si mon rectorat me laisse un souvenir très doux, c'est en grande partie à votre sagesse intelligente que je le dois. —
En donnant libre cours à de tels sentiments, je pense à vous, mon cher successeur. Les expériences de vos devanciers suffiraient à dissiper toutes vos inquiétudes, si vous étiez homme à trembler devant une tâche ou une responsabilité. A ces expériences vous avez joint les vôtres, puisque du rectorat que vous inaugurez officiellement en ce jour, un quart, et non le moindre, est déjà tombé dans le passé. Sic transit gloria... Aussi me paraît-elle étrange l'obligation rituelle qui m'incombe à cette heure de vous présenter au monde universitaire! Si tous les recteurs sortant de charge ont déclaré cette formalité parfaitement superflue, j'ai plus de droits qu'eux tous ensemble de le répéter après eux. Depuis longtemps vous êtes connu, par votre enseignement et par vos travaux remarquables, au pays comme à l'étranger, où vos nombreuses relations vous permettront d'exercer en faveur de l'Université une influence qui jamais ne se sera révélée plus précieuse.
Mais surtout, pendant un semestre, nous vous avons vu à l'oeuvre, déployant vos talents d'administrateur attentif, énergique, et rapide. Et c'est à peine en vérité si j'ai des voeux à formuler aujourd'hui; il me suffit de constater et il m'est facile de prédire que votre rectorat se révèle et restera fécond.
Et maintenant, la tradition m'appellerait à jeter un regard en arrière, et à retracer, dans une sorte de revue, les événements principaux de la dernière période. J'y renonce. Cette revue, il faudrait la faire amusante, je ne saurais; brillante, je n'ose le tenter. Vous souffrirez sans peine que je m'en tienne à l'indispensable. J'adresse un hommage à la mémoire de ceux que nous avons vu disparaître. Des professeurs d'abord, en exercice, honoraires ou démissionnaires, MM. Henri Narbel et Adolphe Combe, Jules Gaudard, John Berney et François Guex. Des étudiants, ensuite, emportés par la grippe à la fin du semestre d'été de l'année dernière. Ce n'étaient pas encore les victimes de la mobilisation du 11 novembre, mais déjà plusieurs étaient tombés sous les armes. C'est pourquoi nous pouvons adresser une pensée émue et reconnaissante à la jeunesse qui affronta la plus sournoise des épidémies, pour sauver la patrie des tentatives criminelles de ceux qui, à l'heure la plus émouvante de l'histoire, le jour même où était signé l'armistice qui consacrait le triomphe du droit sur la violence, ont tenté de saboter nos institutions démocratiques, pour anéantir cette victoire elle-même qui remplissait leur coeur d'une inconcevable amertume. ll y a des tombeaux qui resteront comme des monuments de gloire élevés à notre belle, généreuse et vaillante élite, qui tout aussi bien que celle des nations en guerre, n'a point ignoré le sacrifice de soi-même pour le pays.
J'ai salué les disparus. Quant aux événements passés, je vous en ferai grâce, me bornant à rappeler les trois jubilés qui firent un cadre grandiose à la dernière période rectorale, celui de l'Université au début, celui de M. Vilfredo Pareto au milieu, et comme conclusion celui de M. Henri Vuilleumier.
Deux traits donnent à cette période sa physionomie caractéristique. C'est tout d'abord l'élaboration du nouveau règlement général, rendue nécessaire par l'entrée en vigueur de la loi qui nous régit en ce moment. Ce fut long, pénible et ingrat. Puis, un beau jour, ce fut fini. Et tous poussèrent alors un profond soupir de soulagement. Je n'y reviendrai pas. Le second trait, c'est la guerre, avec ses conséquences diverses: vacances prolongées faute de combustible, et ces mobilisations répétées qui nous enlevaient une bonne partie de :nos disciples pendant deux, quatre, parfois six mois en une seule année. Vous les avez supportées, Messieurs les étudiants, avec une patience que j'admire encore. Vous aviez la triste sensation du temps perdu, dans cette longue attente qui vous démoralisait; il y avait des heures où la bataille eût été comme un soulagement et une détente. Mais vous saviez que cette épreuve était nécessaire. Votre courage, au service comme au travail, n'a pas fléchi. Vous êtes restés fermes. Je vous en félicite, moi qui vous ai vus à la fois à l'auditoire et dans vos monotones tranchées.
La guerre a eu d'ailleurs de tout autres résultats. Elle a fait de ces deux années le rectorat des internés. Les internés! Quelles images vivantes, intensément colorées, ce seul mot n'éveille-t-il pas? Je n'évoquerai point ici le succès, un peu effarant, que remportèrent les uniformes si élégamment portés auprès d'une certaine jeunesse, et demi-jeunesse féminine. L'Université n'en a jamais été jalouse. Elle aussi fut assidûment courtisée. Belle, dans tout le rayonnement de ses vingt-cinq années, elle paraît avoir exercé sur nos hôtes en pantalon rouge ou en costume bleu horizon un attrait, un charme, que ses bonnes soeurs romandes n'ont pas eu au même degré. Ils sont venus trois cents papillonner autour d'elle, et ce nombre d'adorateurs s'est maintenu jusqu'à la dernière heure. Ils ont égayé nos auditoires; ils se sont installés; nous leur avons créé des abris déjà solides, en particulier des écoles de droit français et belge qui furent aussitôt florissantes; ils
ont passé des examens; ils ont conquis des grades, des certificats et des diplômes; ils semblaient être devenus des nôtres; leur présence n'étonnait plus; on croyait les posséder longtemps encore...
Et voici, brusquement, emportés par le souffle puissant de la victoire, ils sont partis. Je ne dirai pas que l'Université soit restée là, dans la situation quelque peu ahurissante de la marraine, abandonnée. Pourtant elle avait largement ouvert à ses nouveaux enfants les trésors de son esprit et de son coeur. Elle s'est réjouie, avec eux, de leur départ, mais elle en éprouvait du regret. Elle s'était attachée à cette jeunesse, dont elle ceignait le front de l'auréole de guerre. Elle lui adresse encore un souvenir ému. Elle sait bien que les étudiants internés n'oublieront pas l'Alma Mater, qui, pendant quatre semestres, les a nourris du meilleur de son lait. Il résultera de leur passage une compréhension plus grande et des relations plus suivies, entre les intellectuels de nos pays respectifs. Et si, par l'hospitalité que nous leur avons offerte, nous avons pu contribuer à cet effort de reconstruction que les nations victorieuses ont si vaillamment entrepris, après s'être battues pour sauver le monde, et nous avec lui, de la plus odieuse des servitudes, ce sera la meilleure récompense d'un geste qui ne fut autre chose que celui d'une simple et franche amitié.
Mais, Mesdames et Messieurs, ne nous attardons pas à regarder en arrière, alors qu'il serait plus utile de recueillir nos expériences. Ces deux ans ont été chargés de responsabilités parfois bien lourdes. Par le fait de la guerre, des questions générales se sont posées, plus nombreuses et plus graves que jamais. Il fallait prendre position, répondre brusquement à des besoins nouveaux, organiser autant que maintenir ou diriger, s'orienter au milieu des courants d'idée et de sympathie qui se disputaient notre jeunesse. Et nous avons compris qu'une tradition, pour ne pas dire une routine, ne suffisait pas à notre vie universitaire. Il fallait à notre Haute Ecole, et aux hommes qui la
dirigent, une politique consciente, raisonnée, à laquelle ses chefs successifs resteraient fidèles, s'enchaînant au lieu de se remplacer, se continuant, en se corrigeant s'il le faut, mais sans jamais se démentir.
Cette politique, Messieurs, je ne prétends pas l'avoir inaugurée, ni même l'avoir entrevue dans toute sa précision. J'en ai fortement senti la nécessité, et je tenais à le déclarer aujourd'hui. Elle m'est apparue assez claire, j'ose le dire, dans deux directions d'ailleurs complémentaires: une politique intérieure — je me place au point de vue national — et une politique extérieure. Voici ce que j'entends.
Au dedans, un contact plus intime avec notre peuple, pour lequel nous n'avons jamais cessé de travailler. Il ne s'agit pas de nous transformer en «université populaire», vouée à une vulgarisation qui ne tarderait pas à se réaliser dans le plus triste des sens que l'étymologie puisse donner à ce vocable. Mais, laissant l'Université ce qu'elle est, il faut la rendre plus populaire dans le pays, consolider sa hase en l'appuyant sur tout un peuple qui en comprendrait mieux l'utilité, où personne ne la regarderait d'un oeil jaloux ou méfiant, mais où tous la soutiendraient, l'entourant d'une intelligente et patriotique sympathie.
Or, dans ce rapprochement, c'est à nous qu'il appartient de faire les premiers pas! Il faut que l'Université et le pays fassent corps, si bien que le pays sente qu'il ne saurait vivre sans l'Université, et que l'Université se rende compte qu'elle ne peut rien sans la franche collaboration et la fière confiance du pays. Nous avons tenté un sérieux effort dans ce sens par l'institution de cours du soir; qui s'annonçait comme un succès lorsque de misérables questions de chauffage et d'éclairage ont surgi juste à point pour en suspendre l'exécution. C'était bien, pour Lausanne.
Restaient les autres villes, et restait la campagne. Ailleurs on a réussi à l'intéresser et à la gagner. Certaines sociétés académiques vont siéger à tour de rôle dans
diverses localités de leur canton, conviant à leurs travaux un publie jadis fort étranger à la vie universitaire; des professeurs ont su par des conférences publiques faire part au peuple du résultat pratique de leurs recherches. Nous avons beaucoup à apprendre encore dans un. tel domaine. N'attendons pas qu'il soit trop tard. La guerre d'hier et les luttes économiques de demain nous appellent avec assez de clarté à nous rapprocher, à nous unir, à consolider par une coordination intelligente toutes nos institutions nationales. Caveant consules, dirons-nous à l'Université, en lui adressant le vieux salut: cura ut valeas.
Une politique extérieure, ensuite. La guerre nous l'a tout simplement imposée. Peut-être à cet égard le passage des internés aura-t-il été salutaire. Nul ne vit pour soi-même, pas plus les Universités et les nations que les individus. Nous sommes solidaires du labeur intellectuel qui s'accomplit dans les pays dont nous partageons la langue et la culture. Malheur à l'isolé. Par l'Oeuvre universitaire suisse des étudiants prisonniers de guerre d'abord, directement ensuite à propos de la reconnaissance dans leurs pays respectifs des études faites et des grades conquis chez nous par les internés, nous avons été mis en relations avec les autorités universitaires belges et françaises. Et immédiatement s'est fait sentir le besoin d'un rapprochement, sous la double forme d'un contact personnel d'abord, puis d'une coordination des programmes et des méthodes. L'introduction simultanée, en Suisse et en France, du système des certificats, paraît appelée à simplifier considérablement le problème. Des relations personnelles se sont nouées, avec Dijon, par l'intermédiaire de M. le professeur Abel Rey, et des comités de rapprochement se sont constitués, sous la présidence des recteurs, à Dijon et à Lausanne. Des échanges de leçons, des visites ont été préparées; des conférences données à Dijon par l'un des nôtres, ici par un maître dijonnais, viendront bientôt sceller cette union en inaugurant officiellement ces rapports. Lyon nous a délégué l'an dernier M. le professeur
Goblot pour s'entretenir de questions analogues. Des pourparlers entrepris à Paris, par M. le recteur Lugeon tendent à poursuivre l'oeuvre en l'élargissant encore. Il y a là une orientation nouvelle qui s'esquisse. Il faudra qu'elle soit dirigée par une politique raisonnée et solide, partant d'un principe et pou suivant un idéal.
Cet idéal, c'est la prospérité de notre Ecole et de notre peuple. On peut l'envisager de diverses. manières. Pensant en première ligne au nombre de nos étudiants, plusieurs nous ont conseillé de nous tourner uniquement vers les peuples jeunes de l'Europe orientale. Je crois que ce serait une erreur. Les chiffres du catalogue ne donnent point la mesure de la prospérité de l'Université ni des services qu'elle rend au pays. Et si nous avons moins de ressources à offrir à la jeunesse d'une nation déjà dotée d'écoles admirables, il nous paraît qu'en établissant avec la France des équivalences de programmes et de grades, nous permettrons non seulement à notre Université de recevoir en plus grand nombre des étudiants d'outre-Jura, mais nous donnerons encore à nos étudiants vaudois la facilité d'aller poursuivre leurs études dans une Université française, et tout en conservant leur indépendance d'idées et de jugements, de s'enrichir au contact de l'esprit clair et loyal, à l'intuition rapide et généreuse, de nos sympathiques et glorieux voisins.
Un dernier mot. Je vous l'adresse, Messieurs les étudiants, au moment où nous allons nous séparer.
Vous vous êtes éveillés à la vie consciente et réfléchie au milieu des événements qui viennent de bouleverser le monde. Seuls ils remplissent votre horizon, tandis que pour vos aînés ils sont une tranche de vie, je ne dis pas un épisode, à côté de beaucoup d'autres. Ces événements vous ont jetés dans le désarroi, et .je le comprends. Vous prétendez construire un édifice nouveau, où de pareils cataclysmes seraient impossibles, et je vous en félicite. Le rêve a sa place légitime dans la vie des hommes et des peuples. Mais il est des rêveries maladives qui facilement
deviennent des cauchemars. Il est des visions que pour ma part je crois néfastes. Et je vous mets tout particulièrement en garde contre celles qui volatilisent l'idée de patrie.
Vous avez un pays. Vous lui devez beaucoup. Il a consacré à votre entretien, à votre éducation, à votre instruction supérieure, à la préparation de votre carrière, le plus clair de ses ressources. Parmi ses enfants, vous êtes des privilégiés. Ce n'est pas à vous, éclairés comme vous l'ètes, qu'il appartient de le renier. Vous n'êtes ni à l'âge, ni au niveau moral des noires ingratitudes. Si, en entrant en fonctions, je vous ai appelés à l'honneur, aujourd'hui, en sortant de charge, je vous invite à l'amour, l'amour du pays, jusqu'à la consécration, jusqu'au sacrifice. Vous m'avez écouté, il y a deux ans; vous m'écouterez cette fois encore. Ouvrez les yeux. La ruine des patries entraîne l'effondrement de la civilisation elle-même. Ce recul formidable serait la plus affligeante des catastrophes. L'avenir, j'entends un avenir de progrès, car je crois au progrès, n'est pas dans la négation des patries; il est dans leur association en un organisme humain universel. Un organisme, dis-je, et non point une masse amorphe et mal évoluée; un organisme où chaque peuple exercera sa fonction pour le déploiement d'une vie commune plus riche et plus une à la fois. Dans cet ensemble, ne sauraient prendre place que des pays vivants, sains, fiers et dignes, respectés et honorés, forts par' l'union de tous leurs enfants dans cet amour intense que l'on a pour sa mère, et qui n'exclut en rien l'universelle fraternité.
Etudiants, vous ne cesserez pas d'être des patriotes. La science n'a pas de patrie, je le sais. Il était nécessaire de le dire quand on l'utilisait dans un but de nationalisme exclusif, orgueilleux et dominateur. Ces temps sont passés. Dieu veuille qu'ils ne reviennent plus. Mais leur disparition n'entraînera pas celle du patriotisme légitime. Mettez au service du pays qui vous a faits ce que vous êtes, les ressources de tout ordre que l'Université vous a données.
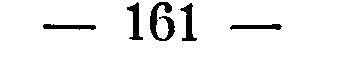
Vous voulez travailler à la fois pour l'humanité et pour
vous-mêmes! Vous ne sauriez plus complètement y réussir
qu'en travaillant avec fierté, et avec amour, pour votre
pays.