LE PROBLÈME DE L'AVANCEMENT DE LA SCIENCE
DISCOURS PRONONCÉ PAR
a l'occasion du Dies academicus de l'Université de Neuchâtel
ALEXANDRE DE MURALT PROFESSEUR ORDINAIRE A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE L'UNIVERSITÉ DE BERNE PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
LE PROBLÈME DE L'AVANCEMENT DE LA SCIENCE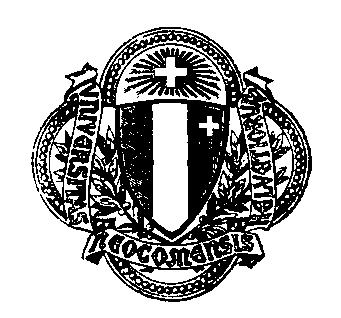
NEUCHATEL SECRÉTARIAT DE L'UNIVERSITÉ 1958
On abuse d'une manière étrange aujourd'hui de l'expression «recherche scientifique» qui, encore au commencement de ce siècle, s'appliquait à une activité intellectuelle du niveau le plus élevé. D'un côté on emploie ce mot pour caractériser, des activités extrêmement banales (on parle de «recherches culinaires», «recherches touristiques», etc.), de l'autre on en abuse pour des démonstrations d'ordre politique qui n'ont plus rien à faire avec l'impulsion qui est à la base de l'entreprise scientifique.
L'Année géophysique internationale (AGI) devait être un effort d'amitié parmi les hommes de science du monde entier, et avoir un but scientifique commun qui embrassait aussi la construction et le lancement de satellites. Avec les Spoutniks (I, II et III) cette «recherche» est devenue un facteur politique de premier ordre et la centrale de l'AGI, à Bruxelles, n'a jamais obtenu de résultats scientifiques de ces expériences magnifiques. Pour la première fois la validité des lois de Copernic et de Newton a été démontrée par une expérience de physique dans l'espace qui entoure notre atmosphère, mais les hommes de science (sauf peut-être les Russes) engagés dans l'entreprise de l'AGI n'en ont obtenu que les informations relatées par la presse soviétique. La promesse de rendre accessibles tous les résultats scientifiques de l'AGI n'a pas été tenue. Nous sommes les témoins d'une dévaluation pénible d'une des
activités les plus hautes de l'esprit humain, de la recherche scientifique.
La recherche scientifique est une activité créatrice de l'homme, remplie d'impondérables et d'imprévus. Les hommes de science ne sont pas des personnages commodes. Ils ont beaucoup en commun avec les artistes au point de vue tempérament et manière de travailler. L'intuition joue un rôle primordial chez les deux. L'artiste et l'homme de science se laissent guider par leur intuition, mais pour l'artiste la technique n'est qu'un outil de réalisation (devant les oeuvres des modernes on se demande souvent si c'est encore le cas!). Pour l'homme de science la technique est un élément intégral de son travail, et c'est surtout la maîtrise d'une nouvelle technique qui lui ouvre de nouveaux horizons. Un dévouement mental complet et un état d'ensorcellement sont communs à tous deux dans la phase créatrice. Le professeur «distrait» et l'artiste «vagabond» sont des figures dont l'empreinte a été prise sur la même matrice spirituelle. La «labilité» et la susceptibilité envers le monde bourgeois et bureaucrate sont souvent les mêmes. Indépendance de la pensée et conception d'idées non conventionnelles sont à la base de la découverte scientifique. Comme l'artiste pionnier, l'homme de science doit souvent subir le mépris pour son oeuvre et lutter contre l'opinion publique de ses collègues — résistance qui souvent devient la plus violente au moment même où le chercheur est en train de prendre pied sur une terre vierge de la science.
L'intensité de la création de chefs-d'oeuvre de la peinture par les écoles flamande et florentine aux XVe et XVIe siècles et l'absence d'une activité semblable en d'autres endroits du monde et en d'autres siècles montrent de quelle importance sont les facteurs extrinsèques pour qu'une époque de fécondité artistique puisse se réaliser. Il en est de même, avec une certaine réserve, pour la fécondité de la recherche scientifique.
Parmi les facteurs extrinsèques favorables à la recherche scientifique, il en est trois que j'aimerais discuter en détail: le rôle du mécène, le rôle de la compétition et le rôle des moyens.
Mécène, chevalier romain et favori de l'empereur Auguste à Rome, se servit de son crédit pour encourager les lettres et les arts d'une façon désintéressée. Depuis le temps des Romains le mot mécène est devenu le synonyme de protecteur des lettres et des arts et je me permets de l'appliquer ici également au protecteur de la recherche scientifique. On pense d'abord à Catherine la Grande de Russie qui accorda une protection exceptionnelle aux savants et aux hommes de science de son temps. Mais cette notion doit être élargie; l'activité des académies des sciences en Italie, en France, en Angleterre (la Royal Society) et en Allemagne doit être considérée sous l'angle du mécénat pour la recherche scientifique. L'intérêt, les applaudissements et les critiques des «fellows of the Royal Society» ont poussé au XVIIe siècle Anthony Leeuwenhoek en Hollande à intensifier et à poursuivre ses recherches microscopiques. La présence d'un forum d'admirateurs en même temps critiques et bienveillants était pour lui un constant encouragement à entreprendre de nouvelles recherches.
La compétition scientifique est un autre facteur puissant. Isaac Newton savait que Gottfried Wilhelm Leibniz était en même temps que lui sur le point de découvrir les bases du calcul différentiel, et vice versa. Ce fait stimulait les deux chercheurs et renforçait l'effort intellectuel. Des exemples de cette nature sont très nombreux aux XVIIe et XVIIIe siècles. En commun avec le désir d'obtenir la reconnaissance des savants réunis dans les académies, la compétition a donné des impulsions très fructueuses à la recherche.
Il est regrettable, mais indéniable aussi, que les académies scientifiques, à quelques exceptions près, ne jouent plus aujourd'hui ce rôle de mécène qu'elles ont tenu dans les siècles précédents. Entre temps le chercheur indépendant a disparu et les universités sont devenues les foyers de la recherche scientifique. L'intérêt d'un roi ou la prévoyance et l'intelligence d'un ministre de l'éducation publique ont souvent été, spécialement au XIXe et au commencement du XXe siècle, à la base du développement étonnant d'une université. Le baron Münchhausen par exemple a créé à Goettingue
une université qui, dès les premiers jours, fut remarquable pour son activité scientifique dans le domaine des sciences naturelles. Une longue lignée de ducs de Hanovre et de rois d'Angleterre ont continué cette magnifique idée d'un seul homme, et elle vit encore aujourd'hui. A la fin de la seconde guerre mondiale, avec l'armée anglaise occupant Goettingue, est arrivé un délégué spécial du roi d'Angleterre et de la Royal Society pour reconstruire immédiatement cette belle université à laquelle un mécène dans les rangs de l'ennemi s'intéressait encore en 1946!
Pour nous, en Suisse, le mécène royal ou ducal, l'académicien même, paraissent suspects et antidémocratiques. Nous acceptons pourtant le mécène industriel qui offre une belle somme, fidèle à la vieille devise: «Point d'argent, pas de Suisse!».
Je considère le mécène sous un angle plus large; c'est l'homme ou l'institution qui s'intéresse à la recherche en tant que telle. C'est l'homme assez élevé et cultivé pour comprendre et apprécier l'oeuvre d'un chercheur. Le mécène critique, tout en facilitant l'activité de l'homme de science à qui il crée une atmosphère stimulante et agréable. Permettez-moi d'examiner notre situation en Suisse à ce point de vue: jusqu'à quel point les responsables de nos universités répondent-ils aux exigences d'un mécénat pour la recherche? Puisque mes remarques sont critiques, j'insiste sur le fait que je traite ce problème de façon tout à fait générale et que je tâche de ne pas être influencé par l'image de personnalités vivantes.
Prenons d'abord l'institution de recteur d'université en Suisse: un savant, élu pour une ou plusieurs années, plein de bonne volonté, mais sans le pouvoir exécutif nécessaire pour créer dans son université un climat favorable à la recherche. Il n'a en général pas d'influence sur le choix de nouveaux professeurs; la durée de sa charge est beaucoup trop courte pour lui permettre de créer une doctrine scientifique dans son université. Même s'il a une idée, il n'a ni le temps, ni les moyens de la réaliser. Certaines universités suisses ont des comités ou des commissions moins temporaires, intercalés entre l'université et le département de l'instruction
publique. Ils garantissent une certaine stabilité, surtout dans les questions intérieures de l'université; ils peuvent établir une tradition et jouer le rôle de mécène. Il y a des exemples où pareille institution a été à l'origine de remarquables décisions en faveur d'une université. Mais ce qui nous manque en Suisse, en comparaison avec les universités de Grande-Bretagne et des Etats-Unis, c'est une direction stable et permanente de l'université, exercée par un homme ayant une formation scientifique et qui dispose d'un pouvoir exécutif pour réaliser une politique constructive. En Angleterre, c'est le vice-chancellor de l'université, en Amérique, en général son président qui sont les responsables d'une conception nette et d'un développement actif. Les directeurs de l'enseignement supérieur en Suisse prennent la place de ces personnalités. Nous savons tous que leur tâche n'est pas facile et que leurs efforts sont considérables. Il faut admirer la façon avec laquelle ils ont fait progresser nos universités dans ces dernières décennies. Dans la génération de mon grand-père, les professeurs ordinaires en Suisse étaient en grande majorité des étrangers. Aujourd'hui ce sont des Suisses, et les bâtiments et laboratoires de nos universités sont remarquables, surtout si l'on compare les sommes qui leur sont attribuées au chiffre de notre population. Nous pouvons en être fiers et reconnaissants. Mais le directeur de l'enseignement est d'abord fonctionnaire de l'Etat. Il faut donc se demander si l'Etat veut assumer la charge de mécène de la recherche? Il faut même se demander s'il peut assumer cette responsabilité. J'ai l'impression que l'opinion publique en Suisse considère nos universités surtout comme des écoles de formation professionnelle (médecins, avocats, professeurs de gymnase, pasteurs, etc.). Leur tâche secondaire, être aussi des foyers de recherche scientifique, n'est pas reconnue en général et le fait que la recherche scientifique est de plus en plus coûteuse rend cette pensée même désagréable. L'homme de la rue, dans notre pays, ne se rend pas compte de deux faits importants: nous vivons dans une époque de science et de technique et, puisque l'économie de notre pays dépend toujours davantage de nos exportations,
nos industries doivent être en mesure d'exiger tout de nos laboratoires scientifiques pour affronter une concurrence mondiale qui devient de plus en plus dure. Dans plusieurs domaines scientifiques, notre pays a acquis une position mondiale beaucoup plus importante que ne le ferait attendre la petitesse de notre pays. Nous comptons une douzaine de prix Nobel, un chiffre qui nous met au premier rang des pays scientifiques quand on le compare au nombre d'habitants de notre pays. L'homme de la rue, en Suisse, ne connaît rien de cette position mondiale de notre science, et nos journaux qui chaque jour consacrent des pages entières à tous les aspects du sport, sont très réservés envers le travail de nos hommes de science.
J'ai été très frappé en Suède de l'intérêt très intense que le public manifeste pour tout ce qui touche à la science. En voici un exemple qui peut servir d'illustration: j'ai dû changer de train dans une petite station de chemin de fer au nord de la Suède. Comme j'étais le seul passager et que je devais attendre plus d'une heure, le chef de gare m'invita à déjeuner. Quand il apprit que je me rendais à l'université d'Upsal, il commença à me raconter qu'à cette université le professeur The Svedberg avait réalisé pour la première fois la construction d'une ultracentrifuge et que cette machine permettait de séparer les protéines. En Suède, c'est la presse quotidienne qui donne des informations systématiques et très bien documentées sur tout ce qui se passe dans le domaine scientifique.
Il est spécialement important que l'Etat et ses organes soient informés des grandes lignes des recherches. Le fait que, dans nos universités, l'accent soit porté davantage sur l'enseignement que sur la recherche n'est certainement pas l'expression d'un mépris de la recherche scientifique. Les laboratoires et les bibliothèques de nos universités prouvent le contraire. Et pourtant il me semble qu'en Suisse, l'Etat ne veut et ne peut pas assumer le rôle de mécène.
Quelle en est la raison? J'ai l'impression que ce phénomène s'explique en partie par notre attachement à l'esprit démocratique et par notre amour de l'équilibre. Les moyens financiers étant
limités, l'Etat a tendance à les répartir aussi équitablement que possible entre toutes les institutions de son université et il ne peut pas se permettre de donner une préférence à certains professeurs. Or, c'est précisément la sélection et la préférence qui justifient le mécénat qui a la liberté de choisir et de gâter! Pour des raisons purement démocratiques, notre gouvernement ne peut pas jouer le rôle de mécène et se contente de fournir des locaux et des laboratoires ainsi que d'assurer une égale distribution des crédits. C'est une solution qui s'impose non seulement en Suisse, mais partout où l'université est entretenue par l'Etat. L'Etat ne veut ni ne peut faire de distinction et c'est une des raisons pour lesquelles il ne peut soutenir la science comme le fait un mécène.
La création de la Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, aujourd'hui Max-Planck-Gesellschaft, en Allemagne, montre comment un de nos pays voisins a tenté de tourner la difficulté. En créant des instituts de recherche pour des hommes de science distingués, la Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft a exercé le droit de mécène et pendant quarante-sept ans elle a favorisé des hommes comme Adolf Butenandt, Fritz Haber, Otto Hahn, Richard Kuhn, Otto Meyerhof, Otto Warburg, à la disposition desquels elle a mis des paradis de laboratoires et des possibilités de travail — un geste que l'Etat, en Allemagne, n'aurait pas osé faire. L'idée de distraire les meilleurs hommes de science d'un pays de leur milieu universitaire pour les placer dans une ambiance favorable à la recherche n'est pas nouvelle: il paraît que son auteur est Wilhelm von Humboldt. Il faut reconnaître que les personnalités scientifiques qui bénéficièrent de ce mécénat ont fait avancer la science de façon remarquable et ont contribué largement au grand prestige scientifique de leur pays. D'autre part, les universités allemandes ont souffert d'être ainsi privées d'un grand nombre de talents, et la recherche universitaire y a été quelquefois réduite au rôle de Cendrillon. Dans d'autres pays le principe de cet exemple a été adopté, mais toujours sur la même base: la séparation entre l'aide de l'Etat et l'aide d'un mécène pour l'avancement de la science. L'effort de l'Etat doit rester impersonnel
et équilibré; l'effort du mécène, qui est dans les divers pays plus ou moins camouflé, est toujours individuel et différencié. Il y a partout une tension plus ou moins sensible entre ces deux groupes, et surtout de la jalousie dans les rangs de ceux qui n'appartiennent pas au groupe des élus. Pour notre pays cette solution est impossible; il faut renoncer à la création d'instituts de recherche pure ad personam et à la création d'une hiérarchie de chercheurs «gâtés». Faut-il pour autant renoncer à toute forme de mécénat? La question se pose en Suisse de façon très particulière.
On peut se demander si la solution d'une université fédérale et d'une école polytechnique fédérale pour tout notre pays n'aurait pas été une bonne formule. Alea jacta est —inutile de méditer — nous avons nos sept universités, notre Haute École à Saint-Gall, l'École polytechnique à Zurich èt l'École polytechnique de l'Université de Lausanne. Il faut tâcher d'en faire le meilleur emploi. On m'a souvent demandé à l'étranger: «Où trouvez-vous les professeurs pour toutes ces universités?». A la base de cette question se trouvent deux problèmes qui sont très sérieux pour nous. L'intelligence et le talent sont des facteurs qui dépendent de l'hérédité. Est-ce qu'une souche de cinq millions d'habitants produit un assez grand nombre de talents scientifiques pour mettre à tous ces postes des hommes de première qualité? Avons-nous les moyens de découvrir ces talents et de les développer? En d'autres termes quel est le chiffre génétique et héréditaire de talents scientifiques en Suisse, et quel est le pourcentage découvert et formé, arrivant à des postes scientifiques ? Personne ne connaît la réponse à cette double question. Mais M. Hummler, le délégué aux occasions de travail, est d'avis que le nombre de talents est grand et que le nombre de ceux que nous formons est très petit. Son effort d'améliorer le recrutement des jeunes pour les carrières scientifiques et techniques est donc très louable. Mais d'où vient cette perte de talents? Elle est en quelque sorte liée chez nous à une réaction très saine. Dans les régions où il n'y a pas de gymnase par exemple, l'envoi au gymnase pose des problèmes financiers pour une famille qui a peu
de moyens. Souvent elle est trop fière pour accepter une bourse, même si celle-ci est offerte, et le fils, qui aurait pu être un excellent physicien, devient boulanger! Plusieurs problèmes assez graves se posent: Comment découvrir un talent à l'âge de l'école primaire ou secondaire? Comment convaincre les parents et le jeune homme qu'il doit faire des études plus approfondies ? Comment financer le développement de ses aptitudes? Plusieurs commissions, sous la présidence de M. Hummler, sont en train d'étudier ces questions dans le cadre d'un grand projet pour le recrutement de ceux qui sont doués. La Confédération veut agir comme mécène dans la formation des jeunes.
Il est très difficile pour moi d'évaluer ici le rôle du Fonds national de la recherche scientifique. Permettez-moi donc de vous confier un voeu et de vous dire comment j'espère que le Fonds national pourra agir en faveur de la recherche scientifique. Un exemple, émanant d'une discussion qui eut lieu lors de la fondation, l'explique mieux que beaucoup de paroles. Le désir a été exprimé que le Fonds national envisage le versement de sommes fixes aux universités qui en régleraient elles-mêmes la répartition. Quel aurait été le résultat si l'on avait accepté ce principe? Une distribution plus ou moins égale entre tous les professeurs de l'université!
Qui, je le demande, au sein d'une université, aurait pris l'initiative de la discrimination, qui aurait rejeté une requête et qui aurait eu le courage d'attribuer une grande somme à un professeur et une petite à un autre? On se heurte au même obstacle qui empêche l'Etat de jouer le rôle de mécène. Avec la création du Fonds national, nous avons obtenu en Suisse une organisation qui peut protéger et encourager l'avancement de la recherche d'une manière sélective et nuancée. Le programme du Fonds national a compris jusqu'à présent trois formes de contribution: le subside aux jeunes chercheurs, le subside de recherche et le subside de publication. Une quatrième forme vient d'y être ajoutée: le subside personnel, qui permettra de faire revenir de jeunes savants suisses de l'étranger,
d'offrir des postes de maîtres de recherches à des savants qui se sont distingués et pour lesquels nos universités n'ont pas de place libre correspondant à leur talent. J'ai l'espoir que cette nouvelle forme de subside, une fois bien établie et lorsqu'elle aura passé les maladies de l'enfance, rendra le plus grand service au développement de la recherche en Suisse.
Le deuxième point important pour la vie scientifique, c'est l'ambiance. Prenez, par exemple, le fameux Cavendish Laboratory à Cambridge. Quelle ambiance! Et quels hommes! Sir J. J. Thomson, Francis William Aston, Lord Rutherford — pour ne citer que quelques noms dont l'oeuvre est à la base de la physique moderne. Je ne connais aucun laboratoire au monde qui ait produit autant d'hommes distingués que le «Cavendish», et le nombre de prix Nobel en chimie et physique de ce laboratoire est tout près du chiffre qui honore notre pays entier! La raison de ce succès? Elle est dans l'ambiance de la réunion d'intelligences, si stimulante pour la recherche et qui donne aux jeunes un entrain qui les emporte pour toute leur vie. Mais, sans doute, le succès du «Cavendish» a-t-il été stimulé par la compétition avec d'autres laboratoires de l'Angleterre et, par irradiation, le «Cavendish» a-t-il fertilisé le travail d'hommes comme Lord Kelvin à Glasgow ou Sir William Bragg à Manchester.
Ces exemples sont pour nous, en Suisse, un encouragement. La décentralisation de nos foyers scientifiques nous permet de profiter de ce stimulant que j 'ai appelé la compétition. Et ici, je dois évoquer un souci sérieux. On a beaucoup parlé, dernièrement, de la coordination de la recherche. En votant de grands crédits pour l'avancement de la recherche atomique dans notre pays, le parlement a émis le voeu que les efforts soient «coordonnés». Peut-on coordonner la recherche pure? La réponse est claire: non, car c'est précisément la compétition entre les chercheurs, entre les laboratoires et entre les universités qui produit les meilleurs résultats. Un dirigisme appliqué aux problèmes de recherche ou aux méthodes d'attaque serait désastreux pour notre pays. Il est évident qu'une
coordination est possible chez nous, dans l'achat de grandes installations de recherche nucléaire et leur utilisation pour la recherche. Elle est possible dans l'emploi et la distribution des outils et des instruments, mais elle est contraire au principe de base de la recherche scientifique. Si l'on voit donc comment est né ce voeu de coordination, il n'en faut pas moins insister sur le fait que le principe ne s'applique qu'à la technique de la recherche, jamais à la méthode et aux problèmes mêmes. La recherche doit rester libre et le nouveau mécène pour la recherche atomique, la Confédération, doit se contenter d'avoir confiance dans le travail scientifique de nos physiciens, techniciens, chimistes, biologistes et médecins. Elle doit s'abstenir de la fameuse conception: «Qui paye commande». La compréhension de nos parlementaires pour ces questions est remarquable et exige l'admiration de ceux qui en profitent dans leurs recherches. Mais il faut le dire: la recherche scientifique n'est fructueuse que si elle reste libre. Cette liberté est peut-être quelquefois un peu coûteuse, mais, à la longue, elle l'est moins qu'une science dirigée, subordonnée et, de ce fait, stérile. C'est l'imprévu dans la recherche qui ouvre de nouveaux horizons. Cet imprévu ne peut donner naissance à une nouvelle conception que dans un laboratoire de recherche libre où le développement n'est pas soumis à un «programme de coordination».
Vienne est la ville de la musique et du théâtre. Pourquoi? Parce que des hommes de talent comme Mozart, Beethoven et Schubert ont trouvé dans cette ville un public à la fois intéressé et critique. C'est l'action et la réaction entre artiste et public qui amènent l'artiste à donner le meilleur de lui-même. Il en va de même pour les hommes de science. Certes, des génies comme Lothar Meyer ou Ignaz Philipp Semelweiss furent, pendant toute leur vie, méprisés par leurs collègues et ont continué à travailler jusqu'à ce qu'ils fussent internés dans une maison de santé. Mais en général, la reconnaissance et la critique bienveillante exercent une influence considérable sur le développement de la science. On a dit que la Suisse est un terrain aride pour les arts. Je crains que ce soit vrai
aussi —jusqu'à un certain point —pour la recherche scientifique. Mais le nombre croissant de fondations privées ayant pour but de faciliter la recherche, et les crédits que la Confédération a votés ces dernières années pour la science suisse sont des symptômes que nous saluons avec le plus grand plaisir et avec reconnaissance. Ils montrent que le terrain aride est en train de se transformer.
Mes chers collègues, permettez-moi de confesser ici que, de cette aridité, nous sommes, nous aussi, un peu responsables. Nous donnons-nous la peine d'expliquer à nos compatriotes, en termes compréhensibles, ce que nous faisons en science? Sommes-nous prêts â écrire un article de journal où, dans un langage simple et clair, nous expliquons les découvertes qui nous passionnent? Ne nous enfermons-nous pas dans notre tour d'ivoire?
Parlant de l'ambiance, il me faut aussi dire un mot de l'ambiance inhibitrice. A Cambridge, en Angleterre, un administrateur spécial fait le tour des laboratoires de l'université, demande aux savants quels sont leurs soucis et fait le nécessaire pour leur donner satisfaction. C'est l'idéal. Mais dans la plupart de nos universités, l'administration est une lourde charge sur les épaules de ceux qui devraient jouir de liberté pour se vouer à l'enseignement et à la recherche scientifique. La responsabilité de l'administration, le travail des commissions et la dispersion des forces d'un homme capable de faire, de la bonne recherche, C'est ce que j'appelle l'ambiance inhibitrice. Nous devons veiller que nos savants ne soient pas étouffés par des charges qu'on devrait confier à ceux qui ne sont pas nés pour la recherche et qui pourraient très bien les assumer. Un de mes amis, A. V. Hill, à Londres, a publié à l'âge dc 72 ans la plus belle expérience de sa vie, l'analyse de la chaleur développée par un nerf en réponse à une seule excitation. Son instrument, qu'il a perfectionné pendant une vie de recherche, lui a permis d'analyser de 20 msec en 20 msec les changements de la production de chaleur, et la précision de son enregistrement thermique dépassait une m μ cal (10 -9 ). Pourquoi? La Royal Society l'a nommé professeur de recherche il y a 20 ans et, depuis lors, il a pu poursuivre
ses recherches sans aucune obligation administrative ou bureaucratique. Voilà un exemple de la fécondité du mécénat scientifique pour le travail d'un homme capable. Il est déprimant de penser aux heures perdues dans nos universités pour des activités qui n'ont rien à faire avec l'enseignement ou la recherche. Il faut convaincre nos autorités que c'est là qu'une aide aux universitaires serait très efficace pour l'avenir de la recherche dans notre pays.
Les sciences naturelles et la médecine ont besoin d'appareils, d'équipement de laboratoire et d'assistance technique. Les temps où une découverte importante pouvait être réalisée avec une boîte de cigares, une bougie et une ficelle appartiennent au passé. Il nous faut des bétatrons, des spectrophotomètres et des ultracentrifuges, si nous voulons garder notre place. Pour nos cantons universitaires, l'accroissement des exigences de la recherche est un souci très sérieux. Ici, de nouveau, la Confédération, par le moyen du Fonds national, doit venir à l'aide et fournir les outils nécessaires à la recherche moderne. Mais il ne faut jamais oublier qu'un appareil ne vaut rien sans l'intelligence et le courage d'un chercheur qui ose faire des expériences considérées comme «impossibles» et qui choisit un chemin extraordinaire. Seules les possibilités techniques unies à l'imagination créatrice sont fécondes. Sans ce deuxième élément, la plus belle technique reste stérile.
On comprend qu'un chef aime à s'entourer d'assistants et d'aides techniques. La recherche exige aujourd'hui non seulement les appareils, mais tant de contrôles et de travaux auxiliaires qu'il semble presque désespéré d'entrer en compétition, sans la collaboration d'une équipe. Cette notion a pris naissance aux Etats-Unis et elle a été imitée en Europe, le plus souvent sans critique suffisante. Le staff et l'équipe, le team, sont très en vogue dans la recherche. Ils ont leurs mérites, et cette façon de travailler a beaucoup contribué au développement «horizontal» de la science. Mais le développement en profondeur se fait aujourd'hui encore par le chercheur individuel, souvent seul. C'est l'ensorcellement d'un homme par son problème qui lui fait trouver la clef d'une porte
fermée pour la foule. L'assistance est une aide, mais en même temps un danger dont souvent n'ont pas conscience ceux qui ont les moyens de s'entourer d'aides techniques. Les chamois dans nos Alpes survivent aux hivers les plus durs quand ils ont faim, mais ils succombent au froid lorsqu'on leur donne trop à manger! C'est une loi physiologique qui s'applique aussi à la recherche. Le manque de moyens stimule l'invention et la découverte chez ceux qui ont du courage. Mais d'autre part, il faut admettre que la pauvreté décourageante inhibe toute activité scientifique. Le fait que, même avec le Fonds national, nos moyens en Suisse pour la recherche restent très modestes en comparaison de ceux des grands pays, est un réconfort pour moi, surtout quand je pense aux chamois en hiver!
Si l'on me demande lequel des trois facteurs extrinsèques pour l'avancement de la science est le plus important, je répondrai: l'ambiance de la recherche. C'est une force si puissante qu'elle peut surmonter la pauvreté des moyens et le manque d'un mécène ou d'un public intéressé. Les Curie nous en ont donné la preuve par leur vie. Ils gardaient le feu sacré dans leur misérable petit chantier et aucune faillite ne pouvait les décourager. C'est cet esprit que nous devons cultiver dans nos foyers scientifiques en Suisse, et c'est là, à mon avis, le facteur primordial.
Jusqu'ici, j'ai parlé surtout des sciences naturelles. Les sciences morales sont dans le présent et l'avenir de la même importance. Pour elles, le rôle du mécénat est peut-être encore plus important que pour les sciences naturelles, qui ont un forum international. L'oeuvre de l'historien ou du philologue est connue dans son pays ou de ceux qui pratiquent la langue de ses recherches. Cependant, à cause de la nature de son sujet, elle ne peut susciter le même intérêt international que les découvertes en sciences naturelles. C'est pour cette raison qu'il faut insister pour que son oeuvre soit reconnue dans le pays où ce savant-là travaille.
Le Fonds national suisse a consacré dans les six premières années de son activité un tiers de ses moyens à soutenir les sciences morales
de notre pays. La somme allouée à un spécialiste des sciences morales est généralement plus petite que celle donnée à un chercheur des sciences exactes; c'est dire que le nombre de savants des sciences morales ayant reçu une aide est plus grand que le tiers du nombre total des chercheurs. Aucune organisation semblable dans le monde n'atteint ce chiffre et je suis convaincu que les fruits de ces efforts vont être très remarquables dans l'avenir.
Il est évident qu'au point de vue du mécénat, de la création d'une ambiance scientifique et de l'augmentation des moyens, nous pouvons encore faire davantage dans l'avenir. Mais ce ne sont que des facteurs extrinsèques qui favorisent la recherche, ce n'est pas encore l'essentiel. Il nous faut surtout des talents!
Il me faut donc revenir sur la question du recrutement et de la formation des talents pour la recherche scientifique. Le problème des bourses a été indiqué. Permettez-moi, en terminant, de relever un autre problème qui me préoccupe et qui me donne beaucoup de soucis. Notre avenir dépend du recrutement technique et scientifique. Comment pouvons-nous inspirer à nos jeunes l'enthousiasme pour les études et pour le travail intellectuel? Ceux qui choisissent le chemin facile, qui ne passent pas par le gymnase, par le technicum ou par l'université arrivent à des positions beaucoup plus intéressantes du point de vue financier, alors que leurs camarades sont encore sur les bancs des hautes écoles. Le nombre d'hommes dont nous avons besoin seulement pour maintenir le niveau de la recherche scientifique est devenu beaucoup plus grand qu'autrefois. Les fils de pasteurs, de médecins et de professeurs ne suffisent plus à remplir la lacune. Il nous faut aussi des talents provenant de familles sans tradition académique. Comment pouvons-nous inspirer de l'enthousiasme et de l'idéalisme à ces jeunes et à leurs parents pour les amener à choisir un chemin plus dur que celui de l'école de commerce? En Angleterre, la Société pour l'avancement de la science organise chaque année des «conférences pour les jeunes». Des hommes de la plus haute distinction scientifique (prix Nobel, etc.) y exposent à des auditoires de 500 à
1000 jeunes gens leurs travaux, leurs échecs et leurs succès. C'est dans ces conférences que le flambeau de la science se transmet invisiblement du conférencier aux jeunes savants de demain. Ce serait un exemple à suivre!
Mesdames et Messieurs! Le problème de l'avancement de la science peut être comparé à un problème de jardinier. Interviennent tout d'abord la qualité de la plante, la richesse du sol et l'exposition au soleil, enfin les soins et l'attention du jardinier. «Mauvaise herbe croît toujours»: ce principe s'applique aussi à la science. C'est le devoir du mécène, qu'il soit une personne ou une institution, une académie, une faculté ou une fondation, de faire le choix des plantes rares et de les protéger contre la force de croissance de la mauvaise herbe. Mais le choix ne suffit pas; il faut faire croître ces plantes choisies dans un sol riche et il faut leur donner davantage d'eau et de soleil. C'est à ce moment que doivent se manifester les moyens et les facilités de recherche. Mais une fois qu'on a planté et protégé, il faut laisser toute liberté aux forces intrinsèques qui font croître et fleurir le jardin, et se restreindre, comme le bon jardinier, à l'observation et aux soins invisibles. Le principe de la démocratie est mal compris si les mêmes soins sont donnés à toutes les plantes dans le jardin. Il est mal compris si on ne soigne que les arbres fruitiers. C'est là une erreur à laquelle nous succombons souvent, surtout en Suisse. Il faut avoir le courage de cultiver les belles fleurs, même si elles ne rapportent rien! Et ceci encore —je m'adresse maintenant surtout à vous, Monsieur le Recteur de l'Université de Neuchâtel —, il ne faut pas croire que les plus belles fleurs ne peuvent croître que dans les grands jardins. Un petit coin de terre, bien ensoleillé et soigné par un jardinier intelligent, peut produire des merveilles. A cette certitude, permettez-moi d'ajouter mes meilleurs voeux pour l'avenir de votre belle Université de Neuchâtel!






